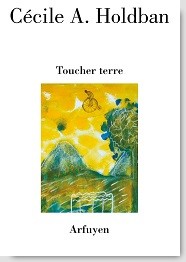|
Laurent Albarracin. Lecture de trois recueils de Cécile A. Holdban : L'Été, Al Manar ;
Poèmes d'après, Arfuyen ; Toucher terre, Arfuyen.
Article paru dans la revue A ní 7, janvier-mai 2020. Mis en ligne le 25 octobre 2020. Aller à la page où Laurent Albarracin présente ses « petites activités éditoriales ».
Une lecture de Cécile A. Holdban L'été
est la saison du verbe être à son paroxysme, mais le participe passé qu'on y
entend suggère déjà un regret, une nostalgie. Il est un apogée dans une courbe
qui ne peut désormais que redescendre ; il est une plénitude, mais
celle-ci semble avoir eu son lieu dans l'enfance. L'été est un cycle à lui tout
seul à l'intérieur du cycle des saisons : il contient son terme et son
germe, son achèvement et son renouvellement. Pour Cécile A. Holdban,
la poésie est comme l'été et elle est comme l'enfance. C'est la saison des
émerveillements, des générosités de la nature, des plaisirs des sens, du
bonheur mêlé de peur, des émotions les plus vives et les plus troublantes.
C'est la saison où les êtres et le cosmos vivent au diapason, au même rythme,
et se mélangent quelquefois. Et la sensualité en particulier est ce domaine où
les sens qui s'éveillent expérimentent une violence qui est franchissement des
limites, confusion des sens et des sentiments, dans la plus grande surprise
souvent : « dans la cour il y avait, à force de courir / un goût de sel,
de fer, de sang. » On dirait que la sensation fleurit à même la peau comme
déjà une réminiscence, comme un souvenir irrépressible et violent qui vient
attiser les sens. Le poème fonctionne alors comme un fouet qui avive ou ravive,
et qui fait prendre la crème des sensations pour en faire un tout englobant, si
ce n'est même un sentiment cosmique. Tous les poèmes de Cécile A. Holdban ne sont pas des évocations de l'enfance, mais tous
s'enracinent dans l'enfance, dans son énergie, et ont leur source dans cet
éveil devant le monde qui est avant tout un élan vers, un désir de. Si
la sensation est violente, ça n'est pas seulement parce qu'elle est vive,
exacerbée, portée à son comble, c'est surtout qu'elle est un moment où se
rompent les amarres et s'ouvrent les vannes, où les sensations multiples
affluent en désordre, abondent et débordent, se mêlent, s'hybrident, échangent
leur qualité propre comme si elles ne pouvaient trouver leur résolution et leur
apaisement que dans l'espace ouvert du poème, dans l'espace tranquillisé et
heureux que le poème leur offre. Car il semble bien que le poème permette de
retrouver des sensations – violentes ou en tout cas intenses – et
en même temps de les réconcilier, de se les concilier, ainsi qu'un espace où le
monde et le moi s'ajustent, trouvent à se mettre à niveau. D'où l'impression, à
lire cette poésie, d'une violence apaisée, d'un flot contenu de sensations
vives et contrastées où les contraires sont comme pacifiés, ou en tout cas
maintenus en respect. La violence existe, mais elle est la loi du poème, sa loi
voulue par tous et qui fait régner le calme, qui établit une sorte de nouvel
ordre – poétique – du monde : « des oiseaux et des tigres
se dévoraient le cœur. » La violence instaure une proximité des êtres où chacun a le droit
d'exister à part égale et ne domine jamais absolument son vis-à-vis. Une sorte
de lutte, mais amoureuse. Ce
qui dans le poème prend en charge cette intensification (disons l'augmentation
de la sensation par la mise en tension du divers), c'est bien sûr l'image.
L'image poétique qui, par le raccourci qu'elle crée (raccourci sémantique et
sensible, le déplacement des sèmes dans la métaphore n'étant que le signe d'une
perception par les sens rendue plus aiguë et rapide), permet de réconcilier les
contraires, ou en tout cas de fusionner ce qui appartient à des ordres
distincts. C'est la grande vertu de l'image que de pouvoir conserver intacte et
active la contrariété de ce qu'elle rassemble au sein de ce qui, soudainement
(de son fait), se ressemble. Une image juste est une image où s'ajuste
l'inconciliable, où un impossible en quelque sorte s'apaise. Tel ce « vol
mouvant des vagues » où une houle d'ailes déferle et en même temps se
ralentit, s'alanguit presque. Vol mouvant des vagues comme un train de
pulsations sur la mer, où le ciel et l'eau se rejoignent, semblent se gonfler
d'espérance, où le haut et le bas s'équilibrent dans un même mouvement continu,
où, alors, oui, « les montagnes d'eau galopent dans la transparence ».
Les images de Cécile A. Holdban sont heureuses :
elles sont réussies, mais surtout elles expriment l'idée qu'il y a un bonheur
possible dans la profusion des choses, et même dans la confusion des choses. Ce
qui se rêve dans les poèmes, ce qui se rêve par eux, c'est une amitié, une
grande amitié entre les choses, où certes la violence perdure (comme un gage
d'authenticité des sensations) mais où les choses viennent s'emboîter les unes
dans les autres comme des matriochkas, comme si l'avalement était encore une
gestation : « un ogre sommeille un enfant blotti au chaud dans son
ventre. » Tout rêve ici, et en rêvant accomplit son évasion : les fontaines asséchées les lions de bronze dévorent leur collier Le poème rêve, et il rêve qu'au bout du poème, à la fin
du rêve, les choses auront recouvré leur liberté, que les statues auront brisé
leurs chaînes et aboli l'inique loi esclavagiste qui les fige. Le poème sait
qu'il rêve, mais néanmoins il rêve que son rêve ne soit pas qu'un rêve, que
viendra un moment où les choses effectivement sortiront de leur cage (et les
mots de la page ?) pour prendre leur élan vers une réalité renouvelée. Rien
n'étanche la soif de ces lions-là, pas même la fontaine du poème. Rêver,
c'est donner à la violence la possibilité de s'exprimer comme éclosion, à la
fois comme défloration et comme efflorescence : Ferme les yeux le ciel est rose derrière de grands pétales de sang
s'effleurent et se dispersent, nuages pourpres un paysage de nage lente où les
mots comme des fourmis s'affairent sans que l'on sache où, vers qui,
vers quelle tâche, quelle cité frêle ils se dirigent. Le poème, s'il reste en contact avec un amont de
violence, se jette en liberté et en confiance vers un horizon fait d'inconnu
mais qui travaille en sourdine à l'amitié des choses et des êtres, fût-elle
conflictuelle ou tout au moins ambiguë : « un banquet se prépare /
dans l'obscurité » : on ne sait s'il s'agira d'un massacre ou d'une
fête. Les deux peut-être. Dès
lors, quelle est la valeur d'un tel titre : « Poèmes d'après » ?
Il est moins nostalgique qu'il y paraît, et sans doute très peu élégiaque. Il
ne s'agit pas de constater la perte de l'enfance, de s'attrister de la
disparition de cette fusion qui eut lieu dans les expériences fondatrices,
mais, au contraire, de rejouer cette enfance dans l'avenir, de réenchanter le monde par le poème et par l'amour. Là où
l'enfance fut une plénitude, le poème, et surtout le poème amoureux, recommence
cette espérance de plénitude. Cécile A. Holdban
n'écrit pas une poésie du retour à l'enfance mais bien une poésie du
retour de l'enfance. L'enfance n'est pas un temps à retrouver (ce sont
là occupations de romancier), mais un temps à redémarrer (ce à quoi s'occupent
les poètes) : Vers l'œil, une route de sel resplendit jonchée de feuilles le cerisier est nu. Même
la douleur, les larmes, le regret de ce qui n'est plus, indiquent encore une
voie pour voir à nouveaux frais le monde, à nouveaux frais et dans sa fraîcheur
nouvelle, dans sa nudité. La nostalgie ne ramène rien du passé, mais elle
ré-aiguise, elle réaffûte le regard. Sur ses chemins brûlants de sel, c'est
l'enfance qui est remise en route, et la poésie est encore élan vers l'avenir. La
poésie véritable n'est d'ailleurs jamais celle qui prétend emprisonner un
morceau de réel et le conserver tel qu'il fut. Bien au contraire elle est foi
dans l'envol : Nos mains avides convoitent la caresse des plumes, la douceur le chant pur des oiseaux. Eux n'ont que faire de ce désir de cage leur cantique est dans le vol. Quand bien même le poème voudrait saisir (qu'il en énonce
le souhait), en réalité il laisse échapper et se contente de ce qui s'enfuit.
Car le vœu secret du poème, du poème « d'après » justement, c'est ce
qui advient après le poème, une fois qu'il est clos et achevé, qu'il s'est
refermé comme sur rien : une envolée, une libération, un regard décillé.
Le poème n'est rien d'autre qu'une manière de relancer le voir. Cela seul qu'il
accomplit, c'est le possible accompli comme possible, c'est-à-dire se situant
sans cesse au devant, toujours à l'avant de lui-même. Alors même l'impossible
redevient un possible : Si la coque du temps se brise et sa graine s'ouvre alors nos morts vivent Le poème ne garde mémoire qu'en tant qu'il ouvre un
chemin nouveau pour que les choses adviennent. La vraie fidélité envers le
passé, c'est la conscience du passage, la sensibilité à la fluence des choses,
la sourde intuition que tout ce qui meurt se mêle obscurément de
renouveau : On n'oublie pas sur les constellations lentes des
rivières gardées par l'aile des fougères, l'ossature pâle des carex les torches de bourgeons où rosit cette mort. Pour la poète, le monde doit être regardé dans le
paroxysme de « cette violence joyeuse » des eaux vives, dans une
explosion d'images, il doit être observé au moyen du tranchant et du
scintillement qu'apportent, par exemple, les orages lorsqu'ils brisent et
rendent le monde à son éclat, à ses couleurs chamarrées et transfigurées (« un vert d'un tel
bleu »). La bigarrure est en effet le signe de la vivacité des
choses ; le divers est la qualité d'un monde richement vécu. Le monde en
chacune de ses parties doit être habité et excité par du vivant qui les révèle
et les vivifie, telles ces « ablettes (qui) strient et constellent cette
portion de ciel dans sa course terrestre ». Un ruisseau est en effet une
portion de ciel mis à terre, mais il l'est à la condition de briller des mille
feux d'une vie animale. On ne peut faire l'expérience du sacré, ou du
grandiose, qu'à la condition d'en jouir terrestrement ;
on ne fait l'expérience de l'Un cosmique que si l'on y constate la profusion du
divers. C'est l'impétuosité qui emporte avec elle le barrage qui sépare
habituellement le sacré du monde matériel, le divin du vivant. L'élargissement
– l'ouverture – peut
d'ailleurs avoir lieu au plus près des choses, l'espace étant alors une qualité
avant d'être une étendue, l'espace étant la requalification de ce qui est par
son attente, sa reconduction dans le désir qu'on en a : « l'horizon,
on le mesure à ce qui tremble ». C'est
bien cela qui nous réjouit dans la poésie de Cécile A. Holdban :
sa manière, comme le dit l'un des titres, de « toucher terre »,
d'incarner généreusement un rapport au mystère du monde en évitant les
abstractions évanescentes, de nous faire toucher du doigt l'emportement des
choses, de retrouver ou de relancer, ici bas et devant nous, les sensations et
les désirs infinis de l'enfance. Laurent Albarracin |