|
Pierre Campion : sur la Correspondance de Mallarmé, publiée par Bertrand Marchal. Mis en ligne le 11 avril 2019.
MonumentalCorrespondance de Mallarmé, édition Bertrand MarchalJuste quelques aperçus sur le monument. Près de 2 000 pages, sous une couverture forte qui tient solidement le livre. Toute la correspondance de Mallarmé connue à ce jour, procurée par Bertrand Marchal avec tout ce qu'il faut, mais juste ce qu'il faut : un avant-propos et une note sur le texte, une table des 3 339 lettres, trois index (dont un des œuvres citées par Mallarmé et un de ses œuvres), une chronologie et une bibliographie succincte et, miracle d'érudition discrète, de courtes et peu nombreuses notes disposées en bas de page, confortablement pour le lecteur. Pour dominer la tâche, dans une édition qui ne soit ni diplomatique ni savante mais une entrée privilégiée dans l'œuvre et dans la vie de Mallarmé, il fallait le chercheur qui, actuellement, les connaît le mieux. Les grandes lettres sont là bien sûr, que Marchal avait déjà, en 1995, réunies commodément pour les chercheurs et commentateurs, en deux blocs : toutes celles des années décisives d'avant 1872 et celles où se réfléchit la pratique poétique de la maturité[1]. Les correspondants de l'expérience poétique sont tous là : Cazalis, Aubanel, Lefébure, Mistral… puis Barrès, Huysmans, Ghil, Mauclair, Verlaine et alii… Mais ils sont pris ici dans le tissu de la vie, éminents évidemment mais réintégrés aux familiers et aux amis, aux journalistes et éditeurs, aux importuns, à des inconnus dont les noms ne nous parviennent plus que par là. Dans ce monument, on se promène familièrement. On suit la brève histoire d'une affaire, minuscule ou majuscule : la préparation avec Deman d'une édition complète des Poésies (elle ne verra le jour qu'en 1899), mais aussi bien la publication d'un article en Angleterre (moins bien rémunéré qu'en France), la manière dont Mallarmé se dépêtre de l'invitation pressante que Paterne Berrichon et « Mademoiselle Rimbaud » lui font d'être témoin à leur mariage, une indisposition qui le tient éloigné de Méry et le dispense aussi de se rendre à ses cours d'anglais au collège… On ouvre le volume nouvellement arrivé, au hasard, au début de l'année 1893, par exemple. On trouve d'abord des vœux de Nouvel An, ainsi à Julie Manet : Celle qui sous le ciel si vite Atteint une exacte hauteur Fleurit, svelte lys et n'évite Qu'à son pied reste le tuteur. Ou à Méry Laurent : Ne t'inquiète pas ! Souci, Hazard, tout un an je souhaite Que rien n'étonne ton sourcil Vaste comme un vol de mouette. Du Mallarmé tout pur. Deux quatrains d'octosyllabes, deux portraits cursifs et complets selon chacun une image. Le sens de la circonstance dans deux personnes diversement animées et diversement fixées, deux situations de femmes, très jeune et d'expérience, deux suggestions définitives d'un mouvement suspendu dans le corps ou le visage : pour ce jour, pour l'année et pour toujours. Et puis, et surtout, le sens et le goût des contraintes, de la prosodie, de la syntaxe et de la métrique et de leurs empêchements mutuels au sein du vers et de la langue. Vers impossibles à lire et à dire selon leur loi propre, si l'on ne place pas, en imagination ou en parole, l'accent de la césure qui, les exaltant chacun à la syllabe 3, en redistribue la grammaire : Celle qui// sous le ciel si vite Atteint u//ne exacte hauteur Fleurit, svel//te lys et n'évite Qu'à son pied// reste le tuteur. Vaste com//me un vol de mouette. Des vers pour ainsi dire distraitement tombés de la Prose pour des Esseintes. Ë ce jeu, Julie, quinze ans tout juste, qui vent de perdre son père Eugène Manet, est sans doute la plus belle des deux, toute prête à poser encore une fois, en pied, pour sa mère Berthe Morisot et à figurer, avec Jeannie et Paule Gobillard, dans le groupe conquérant que Mallarmé appellera encore, dans l'avant-dernier billet de ce volume, fin août 1898, son « cher escadron ». Dans cette pièce, Mallarmé, le tuteur en effet de Julie, déploie en quatre vers l'hommage de son saisissement, de sa vigilante affection et de sa responsabilité, à l'égard de Julie comme de la poésie. Signé par le poète, au dernier mot, de sa fonction familiale et contresigné du monogramme SM, telle Julie son espace de vie le quatrain remplit exactement son office poétique. Continuant de feuilleter ces pages du début 1893, on tombe sur une lettre à Edmund Gosse, un billet à Maurice Barrès, un autre à Paul Verlaine avant son voyage en Belgique comme conférencier, un autre à Albert Mockel pour son mariage, à Méry pour évoquer un malaise de santé et, au vice-recteur de l'académie de Paris, cérémonieuse à souhait, une lettre qui invoque, certificat médical à l'appui, la même indisposition pour « obtenir de votre bienveillance, Monsieur le Recteur, les lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 mars, un congé régulier qui me permettrait de me soigner avec effet et de faire en sorte que le malaise ne dure ». Suggestion toujours, dans l'intérêt du service. Entretemps, quelques pages auparavant, on avait lu un mot du 9 mars au jeune Paul Claudel, mot que Marchal, en note, tient justement pour une définition éminemment mallarméenne du drame claudélien : Mon cher Claudel, Pas une page, sans la surprise de paroles inédites et que profère la bouche humaine, en une farouche, splendide nudité : ces merveilles se groupent puis roulent en chœur prodigieux dans le drame. J'admire comme cela sourd et la force du jet ! Le lieu Théâtre insuffisant à la tragédie de Vie, que la musique et les lettres seules expriment avec son mystère, vous êtes un de ceux qui l'auront superbement transposé en le Livre, notamment par La Ville. Merci, très cher Claudel. Votre ami. Stéphane Mallarmé Trois ans plus tard, au mois de mai 1896, à la maison de Valvins, Mallarmé surveille des travaux, pendant plus de deux semaines. Tous les jours, il écrit, aux « Dames Mallarmé » restées à Paris, son feuilleton : les ouvriers « fugaces et raisonneurs », chacun par son nom, maçon, peintre ou tapissier, qu'il faut faire venir et retenir, et ne pas perdre des yeux, et convaincre de telle nuance de peinture ou de tissu contraire à leur idée de la chose ; les propriétaires qui ne savent pas tout et qui ont fini par approuver, « voyant que leurs devis n'étaient pas dépassés », et concédant même « qu'on repavât, en majeure partie le fournil » ; le bon appétit et les plats gourmands que lui apporte Juliette Hubert, la voisine ; le grand beau temps, les marronniers en fleurs et « les rosiers du mur qui éblouissent » ; lui-même peignant et vernissant la bergère et tous les sièges du jardin en attendant le canot ; les Natanson venus de Paris à bicyclette, « bonne flânerie dans le jardin, devant une bouteille de cidre non tourné ». Surviennent les trois jeunes filles de l'escadron, dans leur propre location, en voisines : « Partagez, ma chère Julie, avec Mesdemoiselles Paule et Jeannie, ma vieille affection »… Au jour le jour, présentes aux gens, aux choses, au vent, à l'air du temps, ces proses-là sont encore du Mallarmé. Et, à la fin, à « Mère » et « Vève », entre l'avant-dernier étouffement et le dernier, ces « recommandations quant à mes papiers », connues certes depuis longtemps, « Jeudi 8 Septembre 1898 pour quand le liront mes chéries » : Le spasme terrible d'étouffement, subi tout à l'heure, peut se reproduire n'importe quand et avoir raison de moi. Alors vous ne vous étonnez pas que je pense au monceau demi séculaire de mes notes, lequel ne vous deviendra qu'un grand embarras ; attendu que pas un feuillet n'en peut servir. Moi même l'unique devais en tirer ce qu'il y a en travaillant l'eusse fait si les dernières années manquant ne m'avaient trahi. Brûlez, par conséquent : il n'y a pas là d'héritage littéraire, mes pauvres enfants. Ne soumettez même pas à l'appréciation de quelqu'un : ou refusez toute ingérence curieuse ou amicale. Dites qu'on n'y distinguerait rien, c'est vrai du reste, et vous mes pauvres prostrées, les seuls êtres au monde capables à ce point de respecter toute une vie d'artiste sincère [?] que ce devait être très beau[2]. C'est une biographie et une autobiographie de Mallarmé, c'est une bibliographie et un commentaire de son œuvre, c'est le complément en un seul volume des deux pléiades (1998 et 2003), un ensemble édifié par Bertrand Marchal, qu'il faut remercier. Pierre Campion [1] Mallarmé, Correspondance complète 1862-1871, suivi de Lettres sur la poésie 1872-1898, préface d'Yves Bonnefoy, édition établie et annotée par Bertrand Marchal, Folio classique, 1995. [2] Là où, à la suite d'Henri Mondor, on lisait jusqu'ici « croyez que ce devait être très beau », Marchal n'est plus sûr du mot. |
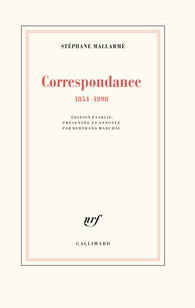 Mallarmé,
Correspondance 1854-1898, édition établie, présentée et annotée
par Bertrand Marchal, Gallimard, 2019.
Mallarmé,
Correspondance 1854-1898, édition établie, présentée et annotée
par Bertrand Marchal, Gallimard, 2019.