|
Pierre Campion : Compte rendu du roman de Mathias Enard, Boussole, prix
Goncourt 2015. Défendre Boussole ?Note sur le roman de Mathias EnardÀ André Hélard On ne s'avance pas beaucoup en présumant que, lisant le Goncourt 2015, d'assez nombreux lecteurs de Boussole n'iront pas au bout de leur lecture. La masse débordante de l'érudition — et notamment une espèce de name dropping irritant et épuisant, me souffle un ami — ainsi que la difficulté du propos pourraient bien faire que le livre tombe des mains… Contre le jugement ainsi proféré — le jugement libre et légitime, souverain, imparable et souvent définitif de la lecture —, on aimerait pourtant plaider en appel. Près de quatre cents pages. À Vienne, c'est la nuit d'insomnie d'un homme malade et angoissé. Cet homme est professeur à l'Université, orientaliste et ethnomusicologue. Assiégé par son savoir, ses échecs et sa vie, il se parle à lui-même : de son amour pour la lointaine Sarah, du milieu où il exerce — ce ne sont que missions et collègues, thèses, colloques, articles et tirés à part —, mais surtout de l'Orient et de l'Occident dans leur rapports obsessionnels et malheureux… Sous le poids de ces références encyclopédiques, de ces évocations et de ces cauchemars, le personnage, l'auteur et le lecteur paraissent devoir étouffer. Plaidons. De la lecture, dans Boussole et en général Premier point. Le lecteur aimerait bien distinguer la réalité de la fiction, en avoir le cœur net, vérifier, et certains tenteront de le faire. À portée de tablette ou d'ordinateur — comme l'insomniaque Franz Ritter guettant ses messages électroniques —, on demanderait à Google si tel voyageur ou voyageuse, tel savant ou tel poète ancien ou tel lieu existe bien ou a existé. Mais bien vite on constatera que cette vérification a été rendue impossible, ne serait-ce que parce qu'il faudrait consulter la documentation deux ou trois fois par page : ou on cherche ou on lit, ou on laisse tomber le livre et les recherches. Lisons. Lisons, c'est-à-dire : abandonnons-nous au mouvement littéralement étourdissant de la narration, tel qu'il anime la masse pesante du récit et de nos réserves. C'est-à-dire retrouvons, au moins comme morale provisoire, la recommandation connue de Coleridge : « cette suspension volontaire de l'incrédulité qui constitue la foi poétique, that willing suspension of disbelief for the moment, which constitutes poetic faith[1] ». De manière délibérée et continue, mettons ici en œuvre cette exigence de la lecture, ce qui revient, remarquons-le, à observer la décision implicite et maintenue qui anime toute lecture de roman. Et donc, pour Boussole comme pour tout roman, acceptons de nous situer dans l'espace mental et dans le temps, difficiles, d'un équilibre entre la foi et le manque de foi, qui est celui où opère toute lecture, mais ici porté à une sorte de limite périlleuse. Consentir, ici, c'est nous livrer à une sorte d'écoute, comme d'une symphonie[2]. Non pas s'inquiéter de la véracité des références, ni même s'adonner à l'analyse de la composition et du style, mais se laisser porter, de confiance, par les thèmes et leur filage. S'exercer à une espèce d'attention flottante : se rendre disponible aux signes et signaux d'une écriture de la parole, à la pluralité des tons, des hauteurs, des intensités, à ses variations et transitions, à un parler sauvage de la vie : « C'est là que se trouve la vie, la vie fragile, dans le lien entre toutes choses. La beauté, c'est le passage, la transformation, toutes les manigances du vivant » (p. 260). Car ce roman est un immense soliloque. En longues phrases, ce soliloque est fluide et orienté, orienté toujours vers l'Orient, comme par une loi cosmologique. Tel est bien sûr le sens de l'objet boussole posé dans la chambre, reproduction censément de la boussole de Beethoven mais trafiquée par Sarah afin qu'elle indique toujours l'est : « L'important est de ne pas perdre l'est. Franz, ne perds pas l'est » (p. 261). Tel est le commandement que s'adressent à eux-mêmes le personnage — et l'auteur —, et que l'un et l'autre adressent au lecteur. Ce soliloque est ordonné selon deux critères, distincts l'un de l'autre et concurrents : par les relevés successifs des heures et minutes de la nuit et par les titres intercalés d'une certaine œuvre impossible à laquelle rêve encore le professeur, Des différentes formes de folie en Orient, obsession tellement prégnante qu'elle fournit ses propres titres à la table des matières du livre, des titres composés dans une police qui imite celles de l'ancien allemand. Et puis il y a cette partie placée en abyme du soliloque (p. 285-311), vingt-six pages en typographie plus serrée, qui racontent la scène des aveux faits à Téhéran par le maître de Sarah, à elle et à Franz, récit annoncé par le narrateur en ces termes : Pourquoi ai-je tenu à faire le récit de cet après-midi-là ? Pour me débarrasser de ce souvenir poisseux, pour en discuter encore et encore avec Sarah, pour l'enjoliver de toutes mes connaissances sur la Révolution iranienne ou pour le plaisir, si rare, d'écrire en français ? (p. 285) Voici donc, en insert, le récit d'un certain amour honteux et mortifère (de Gilbert de Morgan pour Azra, en pleine révolution khomeyniste), qui rappelle à bien des égards celui de Franz pour Sarah et que chacun des deux reçoit comme tel. C'est un écrit en forme et posé au sein d'une symphonie, c'est une scène dramatique instituée au sein d'un récit non dramatique, c'est un récit en petit disant par opposition ce que n'est pas le récit en grand, comme le dramatisme d'Un amour de Swann laisse entendre ce que n'est pas La Recherche du temps perdu : tout sauf un drame. Et cet insert est écrit en français ! Mais alors en quelle autre langue serait écrit l'énorme soliloque qu'est le roman ? D'abord, et censément et justement, celui-ci n'est pas écrit. Constamment, dans l'ordre de la fiction, il doit apparaître comme parole errante, non écrite et rebelle justement à l'écriture : tel est le statut de la parole obsessionnelle dans l'insomnie, telle est la difficulté que rencontre le lecteur. Cependant, dans l'ordre de la réalité, le roman est écrit par un écrivain, Mathias Enard, lui évidemment bien éveillé, présent et vigilant. Mais Enard écrit dans un français particulier, un peu étrange, un français, pour ainsi dire, traduit du soliloque, celui-ci entendu comme une espèce de langue étrangère, un chaos d'images, de mots, de phrases, de locutions jaillies de nulle part… Car il pourrait bien en aller des soliloques qui se produisent dans les nuits d'insomnie comme Freud dit qu'il en va des rêves : on ne saurait y accéder ni en connaître que par le récit a posteriori et séparé de ces soliloques. Dans le soliloque même de l'insomnie, il n'y a ni ordre, ni raison, ni lexique, ni syntaxe que ceux de la détresse, de l'angoisse et de la panique : c'est le récit maîtrisé du soliloque qui institue ici, dans la langue française, un ordre et une raison, et des significations. L'autre de Franz Ritter — celui-ci n'ayant jamais écrit qu'un morceau de récit —, c'est donc Mathias Enard, l'auteur expérimenté de plusieurs livres, et de Boussole. Et l'autre de l'auteur, à un niveau différent d'altérité, c'est le lecteur de Boussole. Dans ces deux configurations de l'un et de l'autre, celui-ci participe de celui-là, mais justement comme un autre, distinct et le même à la fois, en mal à la fois d'identification et de distinction. Toute confusion serait mortelle, et le livre tomberait des mains. Voilà dans quelle posture et dans quel esprit, inconfortables et délicieux, le lecteur bénévole de Boussole doit se placer, constamment. De l'altérité, suite… L'Autre de l'Occident, c'est l'Orient. C'est la thèse de Sarah et c'est l'idée du livre. Évidemment, dans la dialectique qui commande tout le roman, la réciproque est vraie et chacune des deux propositions exprime conjointement la nécessité, la difficulté et même la tragédie plus que millénaire de leurs relations. L'oubli de cette dialectique signifie la guerre, soit par l'exacerbation de l'opposition soit par une perte fatale dans la confusion. Cette difficulté qui, évidemment renvoie aux événements de notre actualité immédiate, c'est celle d'une tension dans l'humanité, entre les continents où elle vit, et en elle-même : le titre d'un article de Sarah, c'est, parodiant un titre de Sartre[3], « L'orientalisme est un humanisme » (p. 105). Un humanisme problématique et douloureux. De même, dans cette géographie de la réciprocité, pour les lieux du monde. Vienne est l'autre de l'Orient, informée par lui et devenant par là son équivalent, son Autre, mais comme sa porte, gardée ici par l'insomniaque : dans la chambre de Vienne, lieu des Lieux, se rêvent Alep, Istanbul, Palmyre et Téhéran, et Paris et Lisbonne et Bornéo, comme dans Proust les lieux de La Recherche (les deux côtés de Méséglise et de Guermantes, et Paris et Balbec et Venise…) animés dans la chambre des réveils. De même l'amour de Franz pour Sarah, essentiellement maladroit, humilié et malheureux, que viennent sauver à peine la nuit de Téhéran et le mot d'espérance à la fin. Lui, terne ; elle, que l'on mettrait en vain sous le boisseau. Lui, professeur conventionnel dans un poste assuré ; elle, « star de la recherche internationale », sans cesse en mouvement et se mettant volontiers en danger. Lui, en attente d'un geste ; elle autonome et presque jamais en demande. L'amour est un mixte souffrant, une expérience privilégiée de l'altérité. L'autre de l'écriture de la thèse, c'est le prologue de celle de Sarah, écrit dans un style très personnel, imbu de Gracq et Kafka et évoquant la figure du romancier iranien Sadegh Hedayat — ce que le jury lui reprocha fort comme de « ton romantique » et « absolument hors sujet », son directeur de recherche, Morgan, la défendant mal. Ainsi il y a donc cet autre insert, plus court, censé recopier le prologue vibrant de « ces deux forts volumes de trois kilos chacun » (p. 9-11), insert double : du style de Sarah dans le style de sa thèse et du style de Sarah dans le non-style du soliloque de Franz. De même enfin, si l'on veut aller aux fondements de Boussole, on peut trouver cette inspiration générale selon laquelle la Fiction est l'Autre de la Réalité, l'ennemie intime et consubstantielle de la Réalité. La fiction doit être pleine et débordante, mais comme l'est la réalité. Et si la fiction nous déborde en effet dans Boussole, c'est comme la réalité nous déborde et nous suffoque, la Réalité trop complexe pour nous, agressivement confuse, saturée de réel, trop forte pour nous : l'étranger radical dans lequel il faut vivre. Ici, on pourrait soupçonner l'influence de Flaubert, mais, de toute façon, Boussole par là pourrait bien représenter la Littérature elle-même : c'est sur la frontière de ce combat contre l'Autre que chaque œuvre doit se vérifier — faire éprouver sa vérité — et non sur la pure immédiateté, convenance et exactitude du propos. Faut-il vraiment défendre Boussole ? Le roman de Mathias Enard se défend bien tout seul. Pierre Campion |
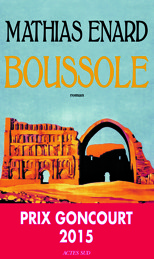 Mathias Enard, Boussole, Arles, Actes Sud, 2015.
Mathias Enard, Boussole, Arles, Actes Sud, 2015.