|
Pierre Campion La figure de Valéry selon Michel Jarrety © : Pierre Campion. Cet article a éré repris, en partie et avec des modifications, dans le livre de Pierre Campion, L'Agir littéraire. Le beau risque d'écrire et de lire, paru en mars 2010 aux Presses Universitaires de Rennes. Les « figures » mises en ligne sur ce site ne sont pas des études ou des articles mais des essais personnels et libres. UN HÉROS TROP HUMAINLa figure de Valéry selon Michel Jarrety1 212 pages de texte. Avec les notes, bibliographie, index et table, c'est un volume de 1 368 pages, et on ne compte pas le cahier de photos en hors-texte… C'est un monument, dans tous les sens du mot, et qui fera longtemps autorité en la matière. Ayant dépouillé tous les documents parus et accédé à bien d'autres conservés ici ou là dans des archives de toutes sortes, privées ou non, Michel Jarrety livre une biographie tellement minutieuse que, à partir des années 1890, pour un peu elle tournerait à l'agenda. C'est le détail d'une vie de pensée, de publications, de correspondances et de rencontres, d'amours et de vie de famille, de conférences (combien de conférences, combien de fois chacune prononcée…), de causeries et de cours, de concerts, déjeuners, dîners, d'interventions publiques : on sait tout de la personne privée, de l'écrivain qui ne voulait pas écrire et du penseur qui voulait savoir ce qui se passe dans la pensée, du personnage devenu peu à peu l'espèce d'intellectuel organique qui finit par des obsèques nationales au Trocadéro — voulues par et en présence de De Gaulle —, son corps accompagné le surlendemain jusqu'au cimetière marin de Sète par des discours encore et par quatre sections de tirailleurs sénégalais. Une biographie nécessaire On ne refera pas ici le procès instruit dans le Contre Sainte-Beuve à l'égard de la biographie des écrivains, procès d'ailleurs peu à peu abandonné désormais et qui valait surtout venant de Proust et dans sa perspective. Exacts conscrits que Proust et Valéry, mais si peu accordés, tellement éloignés à tous les points de vue et s'ignorant de manière presque ostensible, jusque dans leur vie mondaine : vivant chacun dans son univers, rien pour eux n'a le même sens, ni la littérature, ni la vie d'écrivain, ni même la gloire : dans les vitrines des libraires, seuls ses livres veillaient Bergotte. Et ce n'est pas seulement parce que l'un meurt à cinquante ans et l'autre à soixante-quinze que Proust apparaît somme toute si peu de fois dans l'index de Jarrety, bien moins en tout cas que Degas ou Breton ou même Aragon. Et pourtant chacun des deux, selon ses raisons, récuse d'avance le biographe. Jarrety le sait bien, qui, s'agissant de Valéry, s'en explique dès sa préface. Concernant un homme qui n'aimait pas l'Histoire en général ni l'histoire de la littérature en particulier, qui ne croyait pas qu'on pût tirer de l'une ou de l'autre quelque vraie information ni surtout quelque leçon que ce soit, qui se refusait à exercer une influence sur le cours des choses et des êtres, et qui faisait profession de secret sur sa vie intime au point de parvenir à en dissimuler l'essentiel à ses contemporains et, jusqu'à maintenant, à la postérité, il fallait d'abord faire admettre puis démontrer par l'exercice que, justement, la vie de Valéry tient essentiellement et ensemble à son projet de pensée et à la vie de son temps, et qu'elle fut, à sa manière, exemplaire — non pas au sens moral mais comme type et image de ces tentatives inouïes qui se perdent peu à peu dans les sables des existences. Entré lui aussi dans un mort comme dans un moulin (p. 10) mais selon une perspective bien différente de celle que Sartre s'était donnée à l'égard de Flaubert, dans l'idée d'une certaine exhaustivité mais sans la volonté de totalisation dialectique d'un homme et de son temps et sans préoccupation personnelle autre qu'un intérêt presque exclusivement professionnel pour un homme et pour son secret, Michel Jarrety relit son Valéry à mesure qu'il déroule les incidents de sa vie et les événements de sa pensée et, si son héros ne s'en tire pas vraiment à son avantage, ce n'est pas parce que l'auteur aura mené une sorte de procès en forme contre celui-ci ni contre ce siècle dont Valéry fut en effet « plus que Gide sans doute, quoique tout autrement, le “contemporain capital” » (p. 9). Valéry en personnage de roman J'emprunte ici sa formule et son idée à Marc Fumaroli[1]. Voilà un jeune homme qui monte de Montpellier à Paris avec des rêves à la d'Arthez et à la Louis Lambert. Fragile et déterminé à la fois, traversant dès le début des phases d'exaltation et de dépression, peu à peu il va en effet imposer le personnage d'un causeur brillant, d'un écrivain prodigue (dont l'œuvre pourtant, en somme, restera mince), d'un intellectuel au fait de son temps, d'un penseur profond — dont les pensées publiées consisteront plutôt en des feuillets arrachés à un système présumé. En cela bien différent de Gide et de Proust, Valéry ne possédait pas la fortune personnelle qui aurait permis à l'homme de pensée de travailler à son gré à l'élucidation de son intellect[2]. Ce fut donc, dès le début, une existence dépendante (à l'égard de son frère et de sa mère), puis une course à l'argent. Entendons la recherche d'une situation qui, avec « un porte-plume comme gagne-pain », mette un homme et sa famille à l'abri du besoin. D'o¯ l'emploi gagné par concours (et un peu par relations) au ministère de la Guerre, puis le travail plus astreignant que prévu auprès d'André Lebey, dirigeant historique de l'agence Havas, puis, après la mort de Lebey, la course harassante aux conférences et aux charges de toutes sortes, pourvu qu'elles fussent rémunérées : ainsi, parmi les projets qui aboutissent, pour la place de fondateur et administrateur du Centre Universitaire de la Méditerranée à Nice, ce sont des lettres et des visites, des démarches et des négociations, des montages et des tours de table dirait-on maintenant, des déplacements, des angoisses quand surviennent la guerre et l'occupation italienne et que paraissent faiblir l'appui des ministres et la grâce de Jean Médecin… Quant à la chaire de poétique au Collège de France, nous apprenons par Jarrety que la vraie raison de cette création fut d'abord financière et que, passé les premières leçons, le titulaire recyclait telle conférence déjà bien rentabilisée, improvisait plutôt et regardait la pendule. Quelle déception quand le biographe nous rappelle à juste titre comment l'idée et la leçon inaugurale anticipaient des développements qui virent le jour dans les années soixante de la critique française ! Nous savons tout des plaquettes de luxe, des reprises et réajustements des mêmes textes sous divers formats, des corrections mineures qui font nouveauté, des contrats négociés âprement et pas forcément observés, des préfaces accordées au besoin, des conférences passées en préfaces et réciproquement, des oratorios écrits pour telle diva et même, pour finir, des manuscrits vendus, tout cela chiffré dans les francs de l'époque et heureusement exprimé dans notre euro… Nous lisons les efforts que déploient en faveur de Valéry les grandes dames qu'il fréquente et, par exemple, comment telle d'entre elles financera auprès de lui, pendant plusieurs années, un poste de dactylo pour mettre de l'ordre dans ses cahiers en vue de la parution du Livre qui ne viendra jamais. Chemin faisant, nous entrons dans les milieux variés qu'il fréquente et qui ne sont pas parfois sans se pénétrer : salons redorés par les héritières des sucres ou de l'industrie américaine, hôtels particuliers d'un luxe confondant (la maison d'artiste que Gide se fait construire à la villa Montmorency, et qui se révélera inhabitable !), académies aux intrigues forcément complexes et dérisoires, lieux de l'armée, de la diplomatie et de la politique, cercles de la science avancée, ateliers des artistes et boutiques des marchands d'art, et bien sûr le monde de l'édition, de la librairie et de la presse. (Lisons l'index comme une partie de la narration.) Au long de cette vie ordonnée par force et par abandons aux événements de l'histoire, on croise Pétain et de Gaulle (d'abord en plume du Maréchal, mais récusé pour le discours de sa réception à l'Académie), Gide et Claudel, les surréalistes, toute la NRF, des médecins mondains ou non, et jusqu'à la grand-mère d'un tout jeune orphelin de guerre appelé Roland Barthes… Du côté de la littérature, Valéry aura rencontré, souvent ou quelque jour, tout ce qui compte, de Mallarmé, Huysmans et Breton à Malraux, à Saint-John Perse et à Ponge. Non sans courage, le maître bientôt requis de partout s'engage dans les sociétés internationales d'intellectuels et dans des organismes de la Société des Nations, participe à leurs délibérations et les inspire, puis voit s'accomplir la faillite de leurs efforts en faveur de la paix. Dans cette existence d'intellectuel officiel pour l'Europe, chaque jour apporte son souci. Comment ne pas se rendre à une invitation pressante à Lisbonne, car cette visite accréditerait les soupçons de complaisance à Salazar que telle préface a déjà fait naître ? Comment identifier les agents d'influence qui se glissent dans les réunions internationales ? Comment faire rentrer dans le jeu des rencontres d'intellectuels les écrivains allemands sans les mettre en danger dans leur pays ou, inversement, sans cautionner par là leur régime ? Et comment concilier l'amour profond qu'il porte à l'Italie de sa famille maternelle avec la réprobation de plus en plus nécessaire à l'égard du fascisme ? Et puis comment on fait quasiment oublier telle signature commise au moment de l'Affaire Dreyfus, ou comment on reste sur la réserve à l'égard de Vichy, avant de se retrouver in fine monté en icône de la nation libérée. Et puis il y a les femmes. Dans une existence que l'on découvre vouée aussi aux plaisirs de diverses qualités se détachent la silhouette de la comtesse de R., une passion de jeune homme ravageuse et platonique, puis les noms de Catherine Pozzi (« Karine »), la grande bourgeoise fantasque aux exigences impossibles ; de Renée Vautier (« Néère »), la sculptrice de son buste, laquelle aime ailleurs et lui en fait les confidences ; d'Émilie Noulet (« My »), la jeune universitaire fascinée ; de Jean Voilier (« Jeanne »), romancière puis éditrice, laquelle lui portera le dernier coup quelques semaines avant sa mort… Autant de chapitres d'une vie o¯ chacune va à l'homme célèbre avec son genre d'attente et ses exigences, et o¯ règnent exaltations violentes et tendresse, rêves de Pygmalion chez l'un (sculpter la sculptrice et inspirer la romancière, former à sa main son exégète, construire à deux un couple d'élite qui explorerait toutes les ressources de la pensée et de l'amour…), désillusions et lassitude de toutes parts, provocations, récriminations et rebuffades de leur part à elles et, sur la fin, agressions intolérables pour lui. Et aussi, en filigrane, la longue histoire de Paul Valéry et Jeannie Gobillard : leur rencontre quand celle-ci n'est encore, auprès de Mallarmé, avec sa sœur Paule et sa cousine Julie Manet, que l'un des membres charmants de « l'escadron », leur mariage un peu compliqué, suggéré par Mallarmé et scellé autour de sa tombe en septembre 1898, les longues années faites de mensonges, d'aveuglements et d'indulgence plus ou moins forcée, d'humiliations pour elle et d'embarras pour lui, et d'une affection réciproque, jusqu'aux derniers jours de Paul, quand Jeannie revient en force dans le récit. Sous la plume d'un biographe qui, au-delà des images construites par le grand homme et par les circonstances, par les contemporains et par la postérité, restitue les moments réels au mouvement de la vie et de l'histoire, Valéry est bien un personnage de Balzac, lui qui, n'est-ce pas, méprisait le roman, mais c'est un héros qui aura vécu très vite dans l'épuisement. Son agonie n'est pas celle de Goriot ou de Grandet mais d'un homme éreinté que Jeannie assiège de religieuses et de prêtres avant de s'incliner devant sa fermeté, qui ne peut rebondir une dernière fois (« Mais on s'en fout ! », disait-il dans les moments difficiles), et que les transfusions de sang et la toute nouvelle pénicilline procurée grâce au gouvernement ne peuvent sauver de l'usure accumulée par trop de tâches et d'obligations plus ou moins nécessaires, de déceptions petites ou immenses, et d'avanies secrètes. L'abnégation de la littérature Mais ce que Jarrety montre admirablement, à travers le mouvement même de cette usure, c'est le destin d'une grande idée, et d'un homme que cette idée relève malgré tout. Voilà un garçon qui, se payant de culot et introduit par Pierre Louÿs, à l'automne 1891 — il a vingt ans —, à l'occasion d'un séjour à Paris, se rend rue de Rome, un samedi. Il connaît déjà Huysmans et Gide (presque un pays), il commence à écrire des poèmes et à publier çà et là, il va bientôt se former un grand projet. Suivant pas à pas son héros et se gardant bien de se prendre aux interprétations et reconstitutions que celui-ci laissera entendre plus tard, Jarrety raconte les aléas des rencontres, les déceptions, les menus incidents qui font naître une certaine ambition intellectuelle, la transforment en la faisant grandir, l'amènent à des formulations qui cristallisent dans un esprit, celui de Valéry, et dans le personnage de plusieurs petits livres, celui de Monsieur Teste, que les lecteurs confondront volontiers avec l'auteur, celui-ci ne faisant pas grand chose pour les en dissuader. En somme, il s'agissait d'examiner « le fonctionnement réel de la pensée[3] », certes sur des esprits d'exception (Léonard de Vinci, Descartes, Mallarmé, à l'époque du Coup de dés…) mais surtout sur lui-même, Paul Valéry, ce qui n'est pas autre chose que de se proposer l'objectif d'une souveraineté absolue par une expérimentation in vivo sur soi-même. « Te rappelles-tu, écrit-il à Gide, : je te disais abandonner les idées que j'avais dès que d'autres me semblaient les avoir. C'est toujours vrai. Je veux être maître chez moi[4]. » Et, dans un Cahier du tout début : « J'existe pour trouver quelque chose » (p. 153). Et ceci encore, plus tard : « Je ne fais pas de “Système”. Mon système — c'est moi[5]. » Dans la dramaturgie de son existence, il y avait eu, liée à sa passion pour Madame de R., cette première mort qu'il annonçait à Gide : « Un regard m'a rendu si bête que je ne suis plus. » La Nuit de Gênes dans laquelle a tellement compté l'ébranlement affectif dû à la petite comtesse répète et déplace cette mort symbolique : « Je » doit devenir « un autre ». (p. 116) La voilà donc, cette fameuse Nuit de Gênes, d'octobre 1892 ! Lecteur attentif des témoignages divers qui en font état et d'un poème des Cahiers de 1938, Michel Jarrety n'a pas de peine à montrer comment le récit en fut reconstruit sur le modèle du rêve de Descartes et de la lettre de Mallarmé à Cazalis, celle-ci publiée seulement en 1932[6]. Toujours est-il que l'audace, la puissance et la beauté du projet frappent toujours, même narrés ainsi, et justement sans doute parce que narrés ainsi. Voilà donc Valéry à l'observation de sa pensée dans l'exercice matinal de ses deux cent soixante Cahiers, jusque la fin de ses jours. Voilà surtout l'abnégation de la poésie : « Je ne suis ni grand ni poète » (Cahiers, cité p. 491). Jarrety pointe bien le fait : malgré les apparences, ce fut une rupture avec Mallarmé, qui ne l'avait d'ailleurs pas impressionné la première fois. Mais, après ce samedi d'octobre 1891, le Maître était allé encore plus loin dans le défi à la poésie, et Valéry enfin l'admira quand, disciple au statut spécial, il l'entendit lui lire sur manuscrit le Coup de dés. Au-delà, il n'y avait plus que l'amputation, soi vivant, de la poésie, telle que Mallarmé l'avait constatée — et désapprouvée — dans Rimbaud. Mais cette abjuration, elle, valait serment non pas de quitter l'Europe et de se vouer au commerce du café et des armes mais de s'attacher seulement à connaître et à dominer la vie de son esprit, c'est-à-dire sa propre vie réellement vécue : un vœu qui ne sera que trop ironiquement récompensé. Au milieu de la crise qui affecte l'Esprit, au Camarade venu lui confier son besoin d'agir « pendant l'autre gestation en train », et détachant cet impératif, Mallarmé conseillait « Publie[7]. » Valéry, lui, veut sortir des stratégies mallarméennes de résistance qui orientent encore la poésie vers le lecteur comme de la poésie pure à la Bremond qui la reploie sur elle-même, pour entrer enfin dans les mouvements de la seule pensée considérée en soi, sans autre volonté de publication que celle, un jour, de ces observations et des lois ainsi révélées. Ainsi, pense-t-il, se traitera la crise de la Pensée, si elle doit jamais se traiter. Ce sera donc une existence vouée à la seule vie de l'esprit — de son esprit —, et c'est ce projet radical qui, de 1915 à 1925, valut à Valéry les visites, les envois de poèmes et les demandes de conseils, et l'admiration de Breton, d'Aragon et de Soupault, puis les sarcasmes et insultes des deux premiers et de Desnos quand le projet se fut effondré visiblement dans les mondanités, la montre et les publications de raccroc — et avant que Breton lui-même n'avoue, pour le propre compte du surréalisme, que l'aventure du message automatique, elle aussi, avait été « celle d'une infortune continue ». Comme bien d'autres, cette abjuration-là de la poésie valait aussi dénégation, et dénégation vaudra retour du dénié — de la littérature, de la parlerie, des publications de fortune. Car retour vaut affaiblissement : probablement, quand on a traversé cette expérience-là, on ne revient pas à l'écriture et à la poésie sans une déperdition définitive. À lire la biographie de Valéry par Michel Jarrety, on ne peut manquer de reconnaître cette tristesse majestueuse qu'inspire l'échec des grands desseins. Cette espèce de tragédie est décrite ici comme une chute dans le bavardage et les redites, dans la sorte de paresse que suscite la vie dispersée de causeur et de conférencier : pour parler de Goethe, qu'il ne connaît pas, demander le renfort hâtif d'un ami qui le connaît ; frayer avec des mathématiciens ou des physiciens qui ne reconnaissent pas trop ce qu'il leur dit ; oublier de lire les livres certes innombrables qu'on lui envoie de toutes parts, et remercier dans le vague ; rhabiller tel morceau ou telle idée en les démultipliant… Ainsi, cette narration suivie, fondée sur tous les documents possibles et fort nombreux, cet agenda laborieux et presque fastidieux, cette série des amours malheureuses, c'est cela qui nous fait sentir la perte irrémédiable d'une volonté dans l'insignifiance des jours, dans l'entropie qui désarme les idées les plus fortes, dans la terrible usure du Temps. La vie de Valéry ainsi bien racontée, c'est-à-dire en esprit et en vérité, c'est l'exact envers de la Recherche du temps perdu. Pierre Campion [1] Marc Fumaroli : « Michel Jarrety : Valéry personnage balzacien », Le Monde, 8 mai 2008. [2] Jarrety rapporte le mot de Charles-Louis Philippe, lui pauvre, prononcé à propos de Valery Larbaud, le richissime héritier des eaux de Saint-Yorre, qu'il avait conduit chez Gide : « Ça fait toujours plaisir de rencontrer quelqu'un auprès de qui Gide paraît pauvre » (p. 348). [3] La formule est de Breton, pour définir l'ambition du surréalisme, dans le Manifeste du surréalisme de 1924. [4] Lettre à Gide du 10 novembre 1894, citée p. 153. [5] Cahier xxvi, cité p. 152. [6] Cependant… La lettre à Gide du 4 juillet 1891, que Jarrety cite plus longuement p. 99, porte les accents et les formules mêmes de la lettre à Cazalis du 14 mai 1867, que Valéry ne connaissait pas encore. Cette lettre-poème évoque la passion pour madame de R. : « C'est un nouvel ami qui parle, cher André : l'autre âme est quasiment morte. Gardez le souvenir de cette évaporée ; je ne sais ce qu'il va advenir de ma pauvre et tourbillonnante entité. […] Un regard m'a rendu si bête que je ne suis plus : J'ai perdu ma belle vision cristalline du monde, je suis un ancien roi ; je suis un exilé de moi. » [7] « L'action restreinte » (1895), dans Mallarmé, Œuvres complètes II, Gallimard, coll. de la Pléiade, 2003, p. 217. |
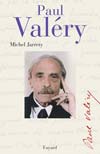 Michel Jarrety, Paul Valéry, Fayard, 2008, 1 368 pages
Michel Jarrety, Paul Valéry, Fayard, 2008, 1 368 pages