|
Henri Droguet : La Mer hivernale & autres poèmes de Derek Mahon.
Mis en ligne le 22 février 2014. © : Henri Droguet. Comment habiter (poétiquement, mais pas seulement) ? Où habiter ?
Telles sont quelques-unes des taraudantes questions existentielles/
métaphysiques qui hantent les poèmes de l'Irlandais Derek Mahon dont Jacques Chuto nous propose un nouveau choix sous le titre La Mer
hivernale aux éditions Cheyne, dix-huit ans après
avoir publié avec Denis Rigal une première sélection
sous le titre La Veille de nuit aux éditions Folle Avoine. Derek
Mahon est né en 1941 dans une modeste famille protestante de Belfast, il a fait ses études à la Royal
Belfast Academical Institution, à Trinity College à Dublin, à la Sorbonne. Il a enseigné à Belfast, à
Dublin, au Canada et aux États-Unis, invité comme poète résident par plusieurs
universités. Il a également été journaliste à Londres et ailleurs. Il a traduit
Philippe Jaccottet et Nerval, entre autres. Il
trace dans ses textes un autoportrait plus ou moins sarcastique, et sans
complaisance, du poète en personne déplacée, hors-sol, ou plutôt
en déplacement, car c'est délibérément qu'il a choisi d'être une sorte de
baladin du monde occidental et autres lieux dont mention est faite dans ses
poèmes (Paros, Paris, New York) avant de faire retour à l'Irlande, à Kinsale, l'exact opposé de Belfast. Si
Mahon a la bougeotte c'est qu'il a été tôt confronté à
la brutalité sanguinaire des affrontements communautaires en Ulster, les « troubles »
comme on dit, et qu'il a refusé de
choisir son camp, s'est mis en retrait : Quelque part,
au-delà Du
pignon roussi Et
des bus incendiés, Un
poète assouvit Sa maudite rage de l'ordre (« La rage de l'ordre ») J'en ai fini avec l'histoire Qui
vit par l'épée
Périra par l'épée.
Dernier des rois du feu, je veux
Rompre avec la tradition (« Le
dernier des rois du feu ») Mahon,
si le sentiment partisan d'appartenance lui est radicalement, existentiellement
étranger, n'ignore pas pour autant d'où il vient : Une fois de
plus, je me souviens de ne pas oublier
[…] Une part de moi-même doit apprendre à savoir d'où elle vient (« Printemps
à Belfast ») et le refus du problématique réenracinement
ne va pas sans malaise :
Peut-être, si j'étais resté, Si
j'avais vécu là de bombe en bombe,
Aurais-je fini par grandir, Et
par apprendre ce que « chez soi » veut dire. (« Vies
ultérieures ») Une
question subsidiaire et insoluble se pose : comment désigner celui qui
n'est chez lui nulle part ? Ni ex-patrié,
ni exilé… Pas de réponse nette. Du
reste, les « réponses » ne se trouvent pas dans le magasin de Mahon
et s'il y a une chose qu'il revendique à plusieurs reprises c'est l'ignorance. L'histoire — avec sa grande hache — est depuis les origines
une accumulation universelle de massacres, de tueries, et si, confronté à « ce
cycle barbare », cette
abomination, Mahon prend le parti des victimes, toutes les victimes, cela ne
signifie pas se poser indécemment comme leur porte-parole, mais plus
modestement en faire mémoire : Ailleurs, on brûle vifs Hérétiques et
sorcières Sur des places
en ébullition. (« Thé
à la neige ») Il y a bien longtemps, l'innommable violence Quand, sur la
grande île, Somhairle Bui,
impuissant, Entendit les
hurlements des femmes de Rathlin Apportés un peu
plus tard par le vent. (« Rathlin ») Disparus
de Treblinka, Pompéi ! « Sauvez-nous,
sauvez-nous, ont-ils l'air de nous dire, Ne
laissez pas le dieu nous abandonner, nous Qui
venons de si loin dans la nuit et la peine. » (« Une
remise désaffectée du comté de Wexford ») L'espèce
humaine dans son arrogance porte la
faute et n'inspire pas à Mahon
une bienveillance immodérée ; ironiquement et implicitement il lui
recommande une salutaire modestie : « Les prodiges sont
légion, mais aucun n'est plus étonnant que l'homme », Qui a dressé le
teckel et taillé la haie Et saisi le
principe de l'arrosoir. (« Glengormley ») Mais
il n'est pas plus indulgent à son propre égard : Quels cons de petits bourgeois nous faisons,
D'imaginer un seul instant Que nos
idéaux confortables Sont
sagesse divine… (« Vies
ultérieures ») Bon Dieu !
Petit puriste puritain, élu de Dieu
et craignant Dieu, (car c'est ce que tu es malgré tes sourires et tes ruses), tu pourrais finir par y prendre goût (églises glacées, rues désertes, chantiers navals silencieux, balançoires enchaînées). (« L'Ecclésiaste ») Ainsi
les hommes sont ce qu'ils sont, le poète est cet homme, comme disait Sartre,
fait de tous les hommes et qui les vaut tous (certainement), et pour rajouter au désastre le monde est
devenu un dépotoir planétaire où le moindre espace est souillé. Cette boîte de vitesses sous la pluie
Au bord du chemin,
Quel dieu grossier fut-elle ? Et cette
insubmersible canette De Coca
qui cogne contre Les
rochers glacés, quelle Néréide ? (« Ovide
à Tomis ») Mahon
multiplie les images de déchetteries géantes qui sont les emblèmes accablants
de la société de gaspillage d'aujourd'hui, de ce monde où la vulgarité
technologiquement avancée et standardisée est en expansion continue. Faut-il
attendre quelque chose de la suite de l'histoire ? Plutôt
attendre la fin des siècles en s'obstinant malgré tout à écrire, à noircir du
papier, mais ne vaudrait-il pas mieux laisser la page blanche ? Comme le
recommande Ovide, ce double fraternel du poète : Il vaut mieux contempler La page
blanche Et la laisser telle quelle Que d'en modifier La substance Du moindre
trait de plume. (« Ovide
à Tomis ») Et,
heureusement, Mahon décide que, oui, laisser quelques mots sur des pages
blanches vaut malgré tout la peine, que cela sauve à peu près la mise, comme
quelques rares et précieuses épiphanies, quelques moments privilégiés de
convivialité, le commerce de quelques frères humains d'autres lieux, d'autres
temps, Ovide le déjà nommé, Uccello, Pieter de Hooch, Camus bien entendu, Munch,
etc., des traces de beauté gratuite comme « une jeune femme qui fait du
stop sur un chemin de campagne » (« La Saint-Patrick »), en
fin de compte ce qui constitue une sorte de sagesse, d'apaisement, d'humanisme
tempérés et modestes, sans illusions ni ambitions démesurées. On
se tromperait fort cependant à chercher dans les poèmes de Derek Mahon un « message »
ou une opinion bien déterminés. Il l'avoue dans un entretien publié dans la Paris
Review :
« Je suis traditionnaliste de part en part. Certains poètes veulent
exprimer certaines choses, être authentiques à propos de leurs émotions, à
propos de la nature du monde et comment ils la comprennent. […] Ils sont
pleins de louables intentions, ce sont des gens admirables, mais ce ne sont pas
des poètes. » La
poésie de Mahon est d'abord de l'écriture âpre, stricte, sobre, limpide, sans
fioritures décoratives, esbroufes ou acrobaties rhétoriques, classique et non
pas académique, qui a recours savamment à tous les modèles formels et toutes
les ressources de la métrique et de la rythmique propres à la poésie anglaise. Mahon
pour qui un poème se voit tout autant qu'il s'entend travaille très
soigneusement la morphologie de ses textes. Par exemple, dans « La chasse
de nuit » et « Jeunes filles sur le pont », les
strophes de six vers ont une forme de losange, les trois premiers vers
croissent en longueur puis les suivants se réduisent progressivement ;
dans « L'aube à l'hôpital Saint-Patrick » on a une variante du même
système prosodique, dans « Ovide à Tomis » et d'autres poèmes
il y a des assonances ou des rimes. La variété des registres de Mahon est
aussi saisissante, des poèmes amplement et souverainement lyriques, et
par ailleurs le laconisme, toujours la mesure et la langue fermement tenue. « Ce qui m'intéresse, dit encore Mahon, c'est la poésie oubliée écrite dans le froid, à découvert, par des solitaires, là où se trouve réellement l'âme humaine. C'est là que pour moi se tient réellement la poésie. » Jacques
Chuto rappelle dans sa préface le principe qui a inspiré ses traductions :
« Me souvenant qu'au XVIIe siècle, on appelait “belles
infidèles” certaines traductions françaises d'œuvres grecques ou latines,
j'ai voulu la fidélité sans renoncer à la beauté. » Il a superbement relevé le défi et il faut le
remercier de nous avoir donné une nouvelle occasion de (re)découvrir
la poésie trop peu connue chez nous
de Derek Mahon. Henri Droguet Pour
aller plus loin : La Veille de nuit, choix de poèmes traduits par Jacques Chuto
et Denis Rigal, éditions Folle Avoine, 1996. Denis
Rigal : Poètes d'Irlande du Nord, Sud, Domaine étranger, 1987. Poètes d'Irlande du Nord, sous la direction de Colin Meir et Jacqueline Genet,
Amiot-Lenganey, 1991. Anthologie de la poésie irlandaise du XXe siècle, sous la direction
de Jean-Yves Masson, Verdier, 1996. L'entretien de la Paris Review (en anglais) sur le net. |
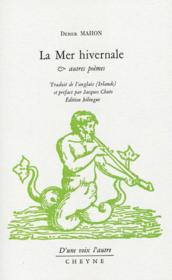 Derek
Mahon : La Mer hivernale & autres poèmes,
traduit et préfacé par Jacques Chuto. Édition
bilingue, éd. Cheyne, collection D'une voix
l'autre, 2014.
Derek
Mahon : La Mer hivernale & autres poèmes,
traduit et préfacé par Jacques Chuto. Édition
bilingue, éd. Cheyne, collection D'une voix
l'autre, 2014.