Hervé Martin : recension du roman de Jean Rohou Une revanche de l'Ankou. Hervé Martin est co-auteur, avec Louis Martin, de Le Finistère face à la modernité entre 1850 et 1900, Rennes, Apogée, 2004, 204 p. Mis en ligne le 4 novembre 2019. © Hervé Martin.
Rohou, Une revanche de l'AnkouCette chronique relatant les destinées entrecroisées de trois familles finistériennes entre 1829 et 1871, agrémentée d'observations ethnographiques du plus haut intérêt, se lit comme un roman et mieux qu'un roman, en un temps où nous sommes abreuvés d'ouvrages nombrilistes, de variations insipides sur le genre et de romans policiers aux intrigues si compliquées qu'ils en deviennent illisibles. Jean Rohou nous transporte donc, à la fin du règne de Charles X, au pied de la montagne d'Arrée, en un bourg imaginaire du nom de Plougwinou, qui tient à la fois de Sizun, de Commana et de Plounéour-Ménez. Nous sommes encore dans le Léon, mais au contact de la Cornouaille : les cléricaux, les blancs, y sont majoritaires, mais les bleus, les héritiers de 89, n'en sont pas absents. Les recteurs y sont très influents, mais on ne saurait parler de théocratie comme à Plounéventer, à Plouzévédé ou à Lesneven. Les trois familles prises en compte par Jean Rohou représentent trois niveaux de la société rurale : les Jézéquel sont des paysans aisés, quoique non propriétaires ; les Santec, également fermiers, appartiennent au niveau moyen de la paysannerie ; enfin les Guidou sont des domestiques, des mevel, condamnés à la misère par le handicap accidentel du chef de famille. Un mariage fait le lien entre les deux premières maisonnées, alors que Saïg Jézéquel et Rozenn Guidou ont une brève liaison adultérine. On notera que la distribution de ce roman ne comporte aucun représentant de la caste des juloded, ces paysans-marchands de toile qui tenaient le haut du pavé à quelques kilomètres de là, dans le pays de Landivisiau Saint-Thégonnec. Les propriétaires ici mis en scène sont un colonel et des notables traditionnels (notaires, pharmaciens, etc.) : âpres au gain, comme de juste, ils ont l'art de faire payer les réparations indispensables par leurs fermiers. Le récit démarre sur les chapeaux de roue par le suicide non élucidé d'une servante engrossée par X et par l'évocation de malheurs ordinaires, acceptés avec une résignation et un stoïcisme encouragés, sinon forgés, par les homélies de l'abbé Pichard. Ce dernier n'est cependant pas un mauvais bougre et se montre favorable, en 1832, à l'ouverture d'une école, dans des conditions d'extrême précarité et avec des moyens très limités. Cet événement est relaté dans des pages magnifiques, et ce qualificatif s'applique à tout ce qui concerne la vie scolaire dans les années suivantes, avec son lot d'affrontements entre les instituteurs et les recteurs et ses inévitables hésitations entre différentes méthodes pédagogiques. J'en recommande vivement la lecture à tous les professeurs des écoles actuels insatisfaits de leur sort, non sans raison d'ailleurs. Ici la petite et la grande histoire s'entremêlent suivant un savant dosage, comme le montre bien la chronologie placée au début de l'ouvrage. A la charnière des deux se placent la construction du viaduc de Morlaix et l'inauguration de la voie ferrée Paris-Brest en 1865, ainsi que la mobilisation des soldats bretons et leur enfermement au camp de Conlie, près du Mans, pendant l'hiver 1870-1871. Si l'arrivée du « cheval noir » est saluée avec enthousiasme par L'Océan, un journal catholique et royaliste de Brest, c'est peut-être parce que certains tronçons de la voie ferrée, entre Guingamp et Landerneau ont été réalisés par l'entreprise Soubigou de Plounéventer. Elle avait à sa tête le fameux François-Louis Soubigou, catholique et monarchiste intransigeant, qui est représenté sur le vitrail du couronnement de Notre-Dame du Folgot, réalisé en 1888. Concernant Conlie, Jean Rohou, loin de se livrer à un cours d'histoire, fait parler Yannig Jézéquel, qui en est revenu profondément marqué. A vrai dire, il faut distinguer deux phases dans l'histoire de ce camp, à en croire le témoignage très précis de Jean-Marie Abhervé Guéguen de Plounéventer : d'abord les grandes vacances, les « délices de Capoue », tant que le sol est gelé et dur et qu'il y a de la paille pour tout le monde ; ensuite la désorganisation complète, la « tour de Babel », quand survient le dégel et que près de 50.000 hommes pataugent dans une épaisse boue collante, sans avoir rien d'autre que des bâtons pour se défendre contre les Prussiens ! Historien talentueux, Jean Rohou est aussi un ethnographe très bien informé, qui ne recule pas devant les considérations techniques, qu'il s'agisse du fonctionnement de la machine à battre le blé, de la façon de creuser un puits, de construire une maison en tournant le dos au beaux-parents ou d'aménager une aire neuve. Les cultivateurs de Plougwinou vont, nous dit-il, chercher le sable et le goémon nécessaires pour amender leurs terres à Plouescat, à trente bons kilomètres, ce qui peut paraître loin. Rien de plus véridique, puisque les habitants de Guiclan, qui se trouve à peu près à mi-route, se plaignent d'un défilé permanent de charrettes chargées de treas et de varech entre la côte et la montagne d'Arrée ! (Cf Yves Miossec, Une vieille paroisse bretonne, Guiclan, 1994). En revanche, on peut être surpris de constater que les agriculteurs soucieux de moderniser leurs exploitations ne lisent pas les Quelennou var labour, Le nouveau guide du cultivateur breton, « avec la traduction bretonne en regard du texte français », publié en 1851 par Théophile de Pompéry, le célèbre agronome de Rosnoën, près du Faou. C'était le manuel le plus connu et nous avons la preuve qu'il a été lu et appliqué à Plounéventer. Cela dit, certains chapitres de ce livre sont destinés à devenir des classiques de l'ethno-histoire, en particulier celui consacré à la « translation », entendons par là le déplacement des os entassés dans l'ossuaire (qui menace ruine) en direction d'une fosse commune, ce qui donne lieu en 1868 à une grandiose cérémonie religieuse, le clergé breton ayant toujours donné la préférence aux morts sur les vivants. C'est à partir du récit très enlevé de ce transfert des ossements que commencent à se lever de possibles réticences concernant le titre. Jusque-là, en effet, il a surtout été question de l'école ou du conflit classique entre routine et innovation. L'Ankou n'a fait que de fugitives apparitions. Il prend sa revanche l'année suivante, sous la forme d'une tragique noyade et de plusieurs décès successifs, et il continue de rôder dans le texte pendant la guerre de 1870, dont tous les mobilisés bretons ne sont évidemment pas revenus. En tant que « Fils de plouc », Jean Rohou est un fin connaisseur de la société rurale, au point de nous donner l'impression de s'identifier à la communauté villageoise quand il emploie le « nous », par exemple à la page 38 et aussi ailleurs. Maîtrisant parfaitement le breton, il nous fait entendre quelques expressions bien de chez nous comme : il est parti drôle, comme de juste, parti pour rester etc. Mais pourquoi pas : chom peoch, « reste tranquille », va lagad « mon Ļil », da bourmen « va te promener ». Très pudique, Jean Rohou se garde de toute grossièreté et fait preuve d'une grande retenue en matière sexuelle, ce qui correspond tout à fait à la réserve des Léonards en la matière. Ces Spartiates de la Bretagne sont des adeptes du laconisme : moins volubiles que les Cornouaillais, ils ont l'art de laisser entendre beaucoup de choses avec peu de mots. Formé à la bonne école du breton, du latin et de Racine, Jean Rohou use d'une belle langue, dense et évocatrice. Il sait aussi émouvoir, quand il s'agit des indigents, des handicapés et des femmes. Plus d'un lecteur sera ému par le parcours de Rozenn, la fille mère précitée, qui finit par trouver le bonheur. En tant que finistérien et en tant que breton, je remercie Jean Rohou d'avoir renoncé pendant quelques mois aux charmes de Bérénice et d'Iphigénie, pour nous permettre cette plongée dans les profondeurs de la société rurale bretonne, entre un Charles X désireux de fermer les écoles primaires et un monsieur Thiers résolu à écraser par tous les moyens la Commune de Paris. Cette Commune qui avait quelques défenseurs à Plougwinou ! Hervé Martin |
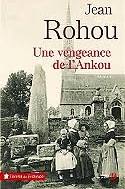 Jean Rohou, Une revanche de l'Ankou,
Presses de la Cité, coll. Terres de France, 2019.
Jean Rohou, Une revanche de l'Ankou,
Presses de la Cité, coll. Terres de France, 2019.