|
Roger-Yves Roche. On réédite Le Fil, de Christophe Bourdin… Mise en ligne le 2 avril 2024.
On réédite Le Fil de Christophe Bourdin, d'abord paru aux Éditions de la Différence, en 1994. On le réédite élégamment, sobrement, avec deux préfaces qui ne le sont pas moins, signées Anthony Passeron et Clément Ribes, des textes qui se tiennent à égale distance de l'hagiographie par trop voyante et de l'empathie parfois débordante. Pendant longtemps, les ouvrages de la collection L'Imaginaire ont été reproduits par procédé photomécanique, ce qui leur conférait une sorte de patine, mais leur donnait aussi une allure d'enfant bâtard, comme s'ils n'étaient que le clone de leur prime ancêtre. Depuis quelques années, l'impression, c'est le cas de le dire, n'est plus la même : le lecteur a affaire à des livres recomposés, réétoffés, augmentés et qui semblent ainsi bénéficier d'une seconde chance, sinon d'une seconde vie, presque une seconde première fois. Cette seconde vie à laquelle Christophe Bourdin n'a pas eu droit, puisqu'il se découvre séropositif alors qu'il n'a pas trente ans, et qu'il mourra en 1997, des suites du sida, à trente-deux ans. Juste le temps d'écrire un livre, son premier et dernier et seul livre. Au vrai, il conviendrait peut-être de parler de trois livres en un, ce qui atténue quelque peu la tristesse de savoir qu'un écrivain est devenu écrivain parce qu'il était atteint d'une maladie incurable, et ne pouvait donc espérer écrire au-delà de la mort, qui fut comme son horizon textuel : « Sans date. J'ai confié, d'abord à Gareth, puis à Heidi, ma crainte que la fin de la rédaction de mon livre ne constitue un carrefour, une frontière, une borne sur la ligne de mon agonie, ne marque un aboutissement, après quoi il semblait que tout pût m'arriver. Je leur explique que j'appréhende cette bifurcation de mon destin d'après l'écriture. » Le premier de ce livre dans le livre a donc pour titre Temps des hypocondries, c'est le plus long des trois. On y découvre comment un homme traque depuis toujours les signes et symptômes de la maladie qu'il croit voir se déclarer sur son corps, ad nauseam. Et, de fait, le jour où Christophe Bourdin apprend qu'il est séropositif, c'est presque comme s'il était déjà porteur de la maladie, l'ayant devinée, pressentie, voire devancée. Écrit à la deuxième personne du singulier, chose rare dans la littérature de soi, le Temps des hypocondries alterne phases de doute, de détresse et de minces espoirs. Surtout, le jeune homme, en se tutoyant, parvient à établir une sorte de dialogue entre le malade qu'il est devenu et le jeune homme qu'il continue, malgré tout encore, à être : « Tu te faisais souvent l'impression d'être double. D'être doué d'ambivalence. Il semblait que tu fusses composé de deux individus incompatibles, fractionné en deux hommes successifs, juxtaposés dans le temps…/… l'un souffrant, soucieux de sa santé, allant à l'hôpital…/… l'autre insouciant, plein de vitalité, souriant…/… Que tu vécusses deux vies contraires. À des âges différents. » Tout autre (quoique prolongeant, et parfois reprenant des éléments de la première partie) est le deuxième temps du livre : celui de l'agonie, qui prend la forme d'un journal au présent. L'écrivain y scrute les signes de sa disparition à venir, note la dégradation de son état, la façon qu'a son corps malade de lui échapper, quand bien même il userait de tous les stratagèmes pour différer l'issue finale d'une maladie qu'il faut bien appeler par son nom : mortelle. Il y a dans le style de Bourdin une manière à la fois clinique et poignante de se regarder dans le miroir de la maladie, de dévisager et d'envisager l'autre au miroir de soi, et soi au miroir de l'autre, l'altérité le disputant à l'altération : « Sans date. J'ai toujours redouté, depuis le début, le regard des autres…/… J'ai peur que ces regards qu'on pose sur moi ne devancent le mien…/… j'ai peur de faire à travers eux l'apprentissage d'une mutation, que chaque rencontre ne soit pour eux l'occasion de reconnaître le malade que je deviens ou risque de devenir…/… Ne produise de la maladie. Ne finisse par devenir ma maladie elle-même…/… Avec eux, je me vois. » Sans oublier que le je qui s'énonce dans ces pages est un je qui tente de retenir la substance, la matière de la vie alentour, comme un regard qui absorberait, chaque fois pour la dernière fois, les signes de son appartenance au monde : « Sans date. J'ai rêvé, dans un train qui me reconduisait ce soir chez moi, en regardant dehors par un carreau, en me laissant séduire par les oscillations régulières du compartiment et le bruit des traverses, endormeur comme un médicament, d'être, comme ces milliers de lumières électriques qui imprimaient la nuit de la banlieue qu'on traversait (lampadaires, phares furtifs des voitures, enseignes, néons clignotants, éclats d'ampoules derrière des vitres, au voilage d'un rideau, dans le rectangle d'une fenêtre), j'ai rêvé que j'étais, comme ces étoiles urbaines, disséminées sur terre comme si le ciel, en se penchant, s'y reflétait, un peu partout, multiplié ou divisé, afin de ne me retrouver précisément nulle part. » Longue phrase à couper, et perdre le souffle. Vision belle comme une apparition. Et triste comme une disparition. Bourdin a beau continuer de désirer (des paysages, des corps, des rencontres, des amours) il sait que ce désir est et sera de courte durée. Telle page pourrait faire penser que le livre de Bourdin ressemble à un long et douloureux monologue introspectif ; il n'en est rien. La réception du sida dans les années 80-90 y est décrite avec une acuité remarquable, et donne à entendre une époque aux prises avec un mal dont on ignore et l'origine et le développement et le terme. Ne sachant, bien souvent, comment l'appréhender : « Sans date. Un ophtalmologue m'avoue, l'autre jour, à ma dernière auscultation des yeux, que le sida se trouve parfois à l'origine d'énigmes médicales, d'affections insolites, de maux rarissimes ou inconnus qui dépassent largement la compétence et l'entendement de tous les spécialistes. Il dit, Certains cas stupéfient par leur primarité. » Le Fil se clôt sur l'évocation d'un rêve au conditionnel, un nous qui narre une histoire d'amour qui arrive par la force des mots et n'arrivera pas. La faute à ce foutu virus. Là se trouve peut-être la vraie, la seule seconde vie : celle d'un écrivain, que l'on peut continuer, ou recommencer de lire aujourd'hui : « Je déteste qu'on meure. » Roger-Yves Roche |
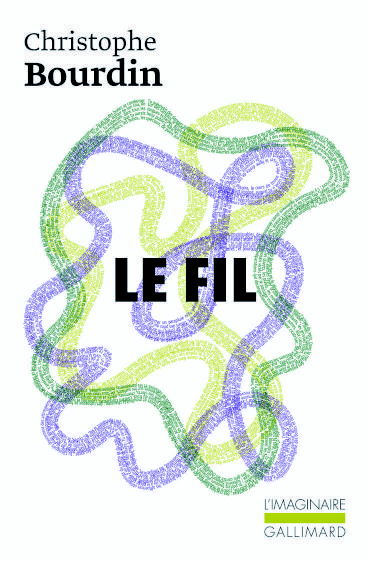 Christophe Bourdin,
Le Fil, L'Imaginaire/Gallimard, 188 pages, 11 €
Christophe Bourdin,
Le Fil, L'Imaginaire/Gallimard, 188 pages, 11 €