|
Thierry Romagné : Haute couture, sur Si décousu, de Ludovic Degroote. Thierry Romagné est professeur de
Lettres. Collaborateur
régulier de la revue Europe, il est aussi l'auteur de
catalogues de peintres contemporains.
Haute coutureOn
peut sans doute s'étonner de ce qu'un ouvrage comme celui-ci, constitué
essentiellement de poèmes en vers mais aussi de quelques pages de prose, de
textes publiés en revues, en plaquettes, dans des livres d'artiste voire, pour
un gros tiers d'entre eux, de complets inédits, soit ainsi intitulé Si décousu.
Est-ce ironie déconcertante, désinvolture assumée, pure inconscience ? La question mérite d'autant plus
d'être posée
que les poèmes se succèdent sans ordre apparent, sans architecture en chapitres thématiques ou autres, sans tenir compte de leur
date de rédaction ou de publication. Le risque existe alors que l'ensemble apparaisse
effectivement très « décousu », de prime abord en tout cas, aux yeux du
lecteur. Mais si ce dernier fait preuve d'un peu de persévérance, il touchera rapidement
du doigt que c'est la vie elle-même qui paraît telle à l'auteur. Lui sait bien,
au contraire, qu'il reste le même, désespérément le même : « je vis
en amateur / je ne réussis pas à faire autrement / je n'invente rien, j'essaie
de tenir bon / dès que je m'en vais je suis dans la pente / je regarde la mer
et je suis dans la pente / je n'ai plus besoin de montagne / ni de marécage /
tout cela paraît si décousu alors qu'on ne sort pas de sa ligne : on ne se
défait pas de ce qu'on est / par delà les piles des ponts / nous sommes finis »[1],
écrit-il à la fin de temps // mort. On dirait un de ces paysages de
Claude Gellée traversés d'un cours d'eau qu'un ouvrage d'art, au loin, enjambe mais
dont l'arrière-plan et ses promesses sont devenus
inaccessibles, définitivement hors d'atteinte. Le fil rouge de cet ouvrage sera
alors cette conviction, cette souffrance diffuse, lancinante, insistante. Les
lecteurs qui suivent Ludovic Degroote reconnaîtront les lieux qui sont les
siens depuis ses débuts : la Savoie, les paysages de montagne qui
appartiennent au côté maternel, et plus nombreux, ancrés dans l'univers
paternel, les villes de la Flandre française, la côte d'Opale, la falaise vue
de la mer, la digue, les lieux funéraires. Bien sûr, ses lecteurs savent que l'essentiel
n'est pas là, dans ce décor plus ou moins esquissé selon les textes, mais on
peut apprécier cependant que l'auteur situe ainsi la conscience des choses qui
est la sienne dans un lieu et un temps. Que l'on soit Nordiste ou non, montagnard
ou pas, ils s'inscrivent toujours dans une confondante familiarité avec ce que
nous pouvons vivre là où nous sommes. De plus, si on ne trouve dans si
décousu mention précise du décès de Godeleine, la
sœur disparue dans un accident de voiture alors que l'auteur était âgé de sept
ans (ce qui constitue le sujet central de Monologue, éd. Champ Vallon,
2012), les défunts hantent toujours sa mémoire. On ne peut lire sans émotion le
poignant Novembre. C'est évidemment le mois des morts, de ses ancêtres (dont
on entendait un écho pressant dans Pensées des morts, éd. Tarabuste,
2002), de la visite en famille au cimetière et de cette bière cristallisant
à elle seule une bonne partie du drame (la débâcle économique de cette ancienne
famille de brasseurs, la douleur de l'individu, seul face à l'absence de la sœur,
de la fille) : « je pense aux bières vides / au juke-box aux
frites du port / qui luisaient la nuit dans nos yeux / je pense à lamartine à je ne sais quoi / qu'on avait enterré dedans /
je me souviens de tout / des morts morts depuis trois
cents ans / de ceux qui mourront demain. » Ludovic Degroote vit ainsi, au
milieu des morts, mais aussi séparé d'eux, des morts comme des vivants,
serait-on tenté d'ajouter, dans l'impossibilité d'entrer en contact avec les
autres. La vie n'a pas épargné l'auteur et la disparition tragique de sa sœur n'est
pas le seul drame qu'il ait eu à affronter. Il en résulte dans tout l'ouvrage
une atmosphère d'insécurité, d'anxiété même, de manque de confiance en soi autant
qu'en les autres. Ce sentiment diffus chez lui, dont le centre est partout et
la circonférence nulle part, n'est cependant jamais généralisé ni théorisé d'abord
parce que ce n'est pas une sagesse mais un déchirement démesuré. C'est une
expérience personnelle, singulière. Et c'est en évitant les termes abstraits,
les concepts trop théoriques qu'il entend s'exprimer, en usant d'une poésie à
hauteur d'homme, qui ne force ni la voix ni le drame mais qui se souvient, et qui
écrit avec cette souffrance, ces souvenirs, cette vie séparée des autres. L'auteur n'a
jamais un mot plus haut que l'autre, il a aussi abandonné la majuscule, même à
l'initiale des noms propres : il est dans le constat, simple, sobre, mais
certainement pas anesthésié. Il vit et nous vivons peut-être dans une véritable
et radicale absence à soi : « on existe par le manque », affirme-t-il
dans En creux, « d'un vide à l'autre / on traverse ce qu'on peut »
avant d'ajouter, dans Sans nous que prendre de l'âge, c'est passer « d'une
absence à l'autre ». « on se construit par
effacement », précise-t-il dans le même poème, « on se manque ».
C'est notre humaine condition que décrit ici Ludovic Degroote, notre insuffisance
de nature, notre imperfection ontologique, mais c'est en poète qu'il le fait et
c'est là l'une des grandes réussites de cette œuvre exigeante. On
se souvient que l'écriture blanche dont parla jadis Roland Barthes eut
rapidement comme corollaire l'idée de la mort de l'auteur. Chez Ludovic
Degroote, nous sommes souvent bien en peine de dire si le locuteur vit au
milieu des morts, s'il est mort lui-même ou si ceux qui se pensent vivants ne
sont pas des morts en puissance, des vifs en souffrance, dans l'attente
d'une fin qui ne saurait tarder, mais une chose est sûre en tout cas, c'est que
son expression stylistique ne tend pas vers le neutre. Dans beaucoup de ses
textes, les vers grêles, frêles, se succèdent au rythme régulier des grands
interlignes. Cela octroierait presque, alors, au poème l'aspect d'une échelle
dont chaque barreau est un vers, une échelle permettant à l'auteur de grimper aisément
jusqu'au faîte, mais un faîte qui n'est qu'une fin, une fin définitive car au
bout de l'œuvre, il n'y a rien. Nulle eschatologie, rien d'autre que ce constat
que nous sommes décidément seuls, avec nos morts et nos mots. Certes, la
religion n'est pas absente de ces pages de silence et de souffrance mais cela
reste une pratique familiale, parentale, sans doute vide de sens, et ses morts
ne survivent que dans nos mémoires. Et dans les vers, ces élégies d'aujourd'hui
qu'écrit Ludovic Degroote. Dans
un recueil de cent trente pages comme celui-ci, le risque de l'éparpillement
était réel. Il ne s'agit pas d'affirmer que ces textes conçus à des époques
différentes et destinés à des usages divers ont été calculés pour produire, un
jour, en s'intégrant à ce volume, une cohérence impeccable mais force est de
constater qu'il est possible de les relier les uns aux autres, qu'il existe en
somme une sorte de fil conducteur, ténu, certes, invisible, souvent, mais qui
parcourt effectivement l'ensemble. Un bon couturier au demeurant ne met-il pas
son point d'honneur à faire disparaître les coutures ? C'est ainsi qu'on
passe insensiblement des premiers poèmes évoquant la difficulté de vivre avec
soi, à sortir de soi puis à aller vers les autres avant d'aboutir à ce Llaenver-Blaenavour, incroyable texte en prose qui
clôt le livre, relatant, pratiquement en temps réel, un trajet automobile entre
ces deux villages du pays de Galles[2].
Le récit est aussi laconique que la lande est vide et il se clôt sur ce constat
qu'on est traversé par le paysage autant qu'on le traverse, mais que les deux
ne peuvent se rejoindre, que l'osmose n'aura pas lieu. On reste seul, dans l'habitacle,
sur la route qui, on le devine en se remémorant le dernier vers de 9 exils
« nous ramène à la maison » plus qu'à la raisonÉ En
même temps, mais hors commerce, paraît Des queues, poème typographique
rédigé en 2008. Les queues, c'est ce qu'il reste, c'est un questionnement sur
notre vision du déchet. Cela désigne ici d'abord les queues des tomates servant
à faire une drôle de ratatouille mais l'auteur nous prévient : ne nous
précipitons pas trop vite sur une interprétation symbolique. Ces
queues nous permettent d'accéder au geste vrai, débarrassé de l'habitude, dans
la proximité du reste, de la mort. Car « nous ne vivons de rien »
affirme l'auteur en renversant étonnamment mais sans doute aussi justement la
formule un peu trop connue. Le poème, n'est-il pas lui aussi « un déchet
du monde » ? L'éparpillement de mots sur la page répond à la perplexité
de celui qui essaie honnêtement de réfléchir à notre rapport au rebut. Et quand
nous jetons ces queues, n'est-ce pas « une partie de notre personne [qui]
disparaît dans ce geste » ? Avec
ce recueil et cette nouvelle plaquette, l'œuvre de Ludovic Degroote apparaît dans
toute son évidence pour ce qu'elle est ; l'une des plus fortes et des plus
cohérentes de sa génération. Saluons l'heureuse initiative des éditions Unes
qui nous permettent aujourd'hui de le mesurer pleinement. Thierry Romagné [1] Les slashes ici n'ont pas été tracés pour indiquer le retour à la ligne à la fin des vers mais par l'écrivain pour donner ce rythme à son texte rédigé en prose. [2] C'est le seul texte du recueil dont il est précisé qu'il est situé sur le sol britannique et dans un véhicule mais n'est-ce pas, précisément, sur une route anglaise que Godeleine a perdu la vie ? |
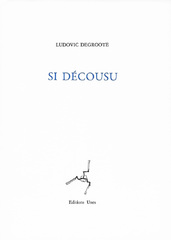 Ludovic Degroote, Si décousu, Éditions Unes, 2019.
Ludovic Degroote, Si décousu, Éditions Unes, 2019.