|
Thierry Romagné : Musique des mondes. Thierry Romagné est professeur de
Lettres au lycée Massillon à Paris. Collaborateur
régulier de la revue Europe, il est aussi l'auteur de
catalogues de peintres contemporains.
Musique des mondesC'est
entendu depuis longtemps, Gérard Macé est du côté des images. De l'image
poétique, d'abord, depuis ses premiers recueils publiés dans les années
soixante-dix, et de l'image photographique aussi, lui qui a consacré quelques
ouvrages aux clichés des autres ainsi qu'aux siens à partir des années 2000. On
se rappelle également ses études si personnelles sur le mime, le cinéma muet et
ce petit volume entièrement dédié à un seul tableau d'un peintre peu connu du dix-septième
siècle, Claude Deruet (La Chasse des dames, 1996, éd. La Pionnière). Pourtant, ce qui
frappe avant tout le lecteur plongé dans cet Homère au titre si littéraire et si visuel
en même temps, c'est sa surprenante musicalité, le rythme indéniable qui
l'anime et qui contribue largement à donner son sens à l'ensemble. Certes, les
évocations précises à l'art d'Euterpe y sont assez rares, à peine évoque-t-on
ici un clavecin que la pluie fait taire, là un concert qui se prépare dans la
maison silencieuse. Certes encore, les vers ne se caractérisent pas eux non
plus par un rythme particulier. Ce sont des propositions qui s'avancent nettement
sur le blanc de la page, préférant souvent éviter les mètres traditionnels et
la régularité strophique (sans se les interdire, cependant). Mais c'est partout
ce même souci de composition selon des rythmes choisis, concertés, et conçus
pour fonctionner les uns avec les autres, les uns après les autres. L'ouvrage
s'offre en trois parties, tels trois mouvements d'une sonate ou d'une symphonie.
La première est un allegro entraînant,
assez rapide même. Le titre de chaque poème y est en fait systématiquement son incipit, si bien que le lecteur est comme
immédiatement happé par un texte pourtant bref (dix-huit vers pour les plus
longs). C'est vif et c'est saisissant. Il s'agit d'une exploration des mondes
obscurs, royaume des morts des Anciens, salles obscures des cinémas
d'aujourd'hui, souvenirs revenant de l'oubli ou réminiscences resurgissant
d'une lecture parfois faite des années plus tôt. Gérard Macé est un fin lettré
qui semble avoir tout lu, tout vu ; au fil des pages la culture la plus
savante côtoie le roman populaire, le poème épique s'y mêle au western des
années cinquante. Mais Gérard Macé ne cherche jamais à nous éblouir par son
érudition, il faut accepter de se laisser emporter dans ce flot d'images et de
mots charriés par le courant, le rythme de cette première partie. L'auteur a su
trouver une belle image pour évoquer ce voyage vers le royaume des ombres
réanimées, celle d'une barque sur un cours d'eau. L'idée n'est pas nouvelle,
mais Gérard Macé sait la retrouver partout où ses yeux se posent, et la
réactualiser. C'est le fleuve Océan du premier poème et c'est la figure
récurrente du nautonier, mais ce peut être aussi l'image plus inquiétante
d'Anubis, le canot de La Nuit du
chasseur, le radeau de La Rivière
sans retour, ou l'une de ces embarcations sur lesquelles il faut monter
pour retrouver celle qui n'a pas de nom, la « Veuve noire » provenant
d'un « roman [d'aventures] dont je n'ai jamais fini la lecture » d'un
certain H. R. Haggard. Cette première partie renoue
avec un thème cher à l'auteur, celui de la mémoire créatrice, la façon dont
notre culture, savante ou non, vit en nous, avec nous, réveillée. Si l'écrivain
constate avec Homère que le fleuve Océan n'est qu'un « ruisseau
tranquille », c'est encore une célébration des charmes de la
« divagation » pour reprendre un mot cher à Mallarmé mais également à
Gérard Macé. Car l'essentiel est dans cette mémoire réactivée pour vivre au
présent, pour comprendre « le vivace aujourd'hui » du poète
symboliste cité dans le texte au moyen du « vorace autrefois » selon sa
propre formule. À cet égard, d'ailleurs, nous sommes davantage sous l'égide de l'autre
Gérard : Nerval. Gérard Macé a commencé son œuvre sous
les auspices du poète d'« El Desdichado »,
et on en retrouve quelques échos ici, même si, curieusement, ce dernier n'est jamais
nommé : « Je suis ce vieil enfant qui se rappelle / les lèvres rouges
de la voisine, le décolleté / des actrices et la décollation des saints. (On se
rappelle que celui qui affirma : « je suis le veuf […], le prince d'Aquitaine
à la tour abolie… » fut amoureux de l'actrice Jenny Colon, avant d'entrer dans son délire mystique.) À
partir de là, chaque instant, chaque détail de la vie quotidienne peut devenir
motif à cette rêverie créatrice : « Une sandale de paille / oubliée
sur le trottoir, une chaussure à haut talon / devant la porte d'un hôtel dont
le nom brille / en lettres de néon : Empédocle et Cendrillon / sont passés
par là, séparés par les siècles / mais brûlant d'un même feu. » On se
souvient de cette sandale qui fut tout ce qui resta d'Empédocle disparu dans la
fournaise de l'Etna comme du fait que Cendrillon doit son nom à ce que, son
travail achevé, elle se reposait dans le foyer de la cheminée, dans les
cendres. C'est ce même principe igné qui est à l'origine du nom de l'auteur. L'un
de se aïeux était « maître de feu, puisqu'il était forgeron […] Il m'a
donné son nom forgé de toutes pièces, / car la mythologie comme les restes du
jour, / ou comme un astre entrant dans l'atmosphère / après une course
apparemment régulière et peut-être un peu folle, / prolonge la vie des dieux
dans le corps des mortels. » (On sait que l'auteur doit son nom à l'homme
qui épousa sa grand-mère paternelle fille-mère.) C'est en remontant les cours
d'eau, en passant par les salles noires comme la mémoire que nous découvrons ce
feu créateur. Allegro fortissimo. La partie centrale, « Les
Restes du jour », sonne quant à elle comme un adagio diurne, contrastant ainsi avec l'atmosphère nocturne du
premier mouvement. Ce sont des poèmes encore plus brefs (huit vers pour le plus
long !) et qui nous donnent à lire tantôt sous un jour itératif tantôt
sous forme d'instantanés (comme on dit en photographie) des moments qui
n'ignorent pas forcément l'affliction, mais sans drame. Même la déchéance d'une
personne âgée est exempte de pathos : « Le vieil homme dont la raison
s'en va / pendant qu'il essaie de démêler / l'invisible écheveau de ses
souvenirs, / une toile d'araignée qui le fait rire et l'effraie. » Les
idées noires ont été laissées dehors, elles brûlent dès le premier poème dans
un « grand bûcher ». Ce sont les jours et les peines d'une vie selon
les saisons, à la campagne, dans la proximité des marées ou de la montagne. La
langue s'est faite plus simple, les références culturelles y sont plus
discrètes. « Les taches de vin / sont de grands nymphéas, / la nappe dans la
lumière / a des transparences de méduse / ou de danseuse entre deux
eaux. » : Si l'on ne prête pas attention au fait que dans le poème
suivant une tête peinte dans « un grand plat d'argent » évoque
irrésistiblement « celle d'un prophète » (saint Jean-Baptiste), qui verra dans cette seule
« danseuse » une allusion voilée à Salomé, ou dans la
« méduse » celle des trois Gorgones qui est mortelle ? Mais
l'impression dominante reste celle d'une vie calme, souvent heureuse, sensuelle
sans être conflictuelle : « les jupes qui se soulèvent / et le ciel
qui se renverse. » C'est la vie humaine avant le travail, vécue dans
une période qui s'étire jusqu'à nous avant que nous atteignions le néolithique,
dans une chronologie toute personnelle à l'auteur : « Était-ce
une aube, était-ce un crépuscule, /ce moment flou hors de l'histoire / où
l'homme enfin domestiqué / s'est mis à labourer son champ, pendant que le chien
se séparait du loup ? » interroge le dernier texte, en utilisant cette
tournure pronominale qui souligne malgré tout la responsabilité de l'homme. Dans
la dernière partie, les distorsions temporelles se font plus abruptes. Cela
semble écrit après le vingtième siècle et même après notre époque. Beaucoup de
verbes pour exprimer notre vie actuelle étant conjugués au passé, le lecteur a
le sentiment d'avoir été projeté dans un avenir à partir duquel il regarde
rétrospectivement un paysage plus halluciné que diurne ou nocturne. Par une
note liminaire, l'auteur prévient que ce n'est pas lui qui parle mais un autre qu'il abrite parfois, un
« homme effaré » qui « revient […] avec l'énergie du désespoir,
[et] qui redonne la force de vivre ». Il faut souligner l'originalité de
cette tentative pour créer une autre voix, une voix échappant à la fois à la
prétendue sincérité du lyrisme subjectif comme aux froideurs de la poésie
objective. Il s'agit plutôt d'une voix assumée comme celle d'un personnage de
fiction. C'est en tout cas une section qu'il faut lire furioso. Les pages regorgent de cheminées d'usines recrachant on ne
sait trop quoi, d'hommes ivres morts dansant avec des femmes enceintes, de
faucilles, de marteaux, de croix nazies. Les journalistes y ont l'air peints
par Francis Bacon : « Enfermés dans des cages de verre, / de
puissants imbéciles à la voix douce / nous lisaient les nouvelles du
jour. » Ce dernier mouvement se termine par une note étonnamment retenue,
mais pleine de développements potentiels, en des distiques découpés au couteau : « Pour
nos enfants que nous enfermons dehors, / nos maisons sont devenues des
coffres-forts. // Nos trousseaux de clés sont leurs trophées, / des anneaux de
Saturne à leurs ceintures. » où l'on est sans
doute fondé de voir une image inversée du célèbre Saturne dévorant un de ses fils de Goya. Ici, ce sont les enfants
qui, d'une façon ou d'une autre, volent, dévorent leurs parents et leur
mémoire, achevant ainsi l'Histoire. La musique qui s'élève de l'ensemble ne cesse ensuite de résonner en nous. Et c'est avec une langue d'une grande élégance, d'une haute tenue que l'ensemble est orchestré. L'écrivain y questionne sur un rythme vif ce que nous pouvons recevoir du passé. Il ralentit le mouvement ensuite quand il évoque les jours sans malheur d'un présent atemporel. Et l'ouvrage s'achève – mais s'achève-t-il vraiment ? – sur un contraste fort, rinforzando, en envoyant le lecteur dans un avenir d'où celui-ci perçoit mieux, avec ce recul qui nous fait si souvent défaut, notre époque toujours menacée par la barbarie et l'oubli. Thierry Romagné |
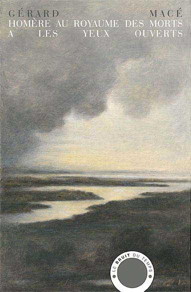 Gérard Macé, Homère au royaume
des morts a les yeux ouverts, Le Bruit du temps, 2015.
Gérard Macé, Homère au royaume
des morts a les yeux ouverts, Le Bruit du temps, 2015.