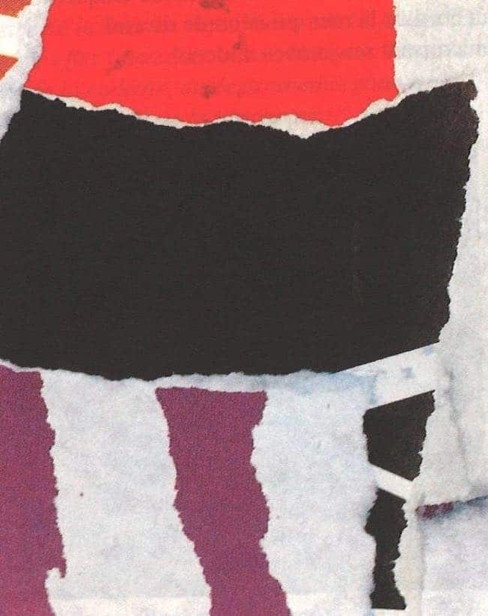|
Alain Roussel : Note de lecture sur le livre de Christophe Dauphin et Alain Breton, Totem normand pour un soleil noir. Mis en ligne le 27 mai 2021. Cet article est repris du site En attendant Nadeau. © : Alain Roussel.
Un lyrisme lucideCritique littéraire, directeur de la revue Les Hommes sans épaules, membre actif de l'Académie Mallarmé, Christophe Dauphin a aussi écrit une vingtaine de livres de poésie et des essais sur des écrivains tels que Jean Breton, Verlaine, Sarane Alexandrian, Henri Rode, Jean Rousselot. Le lire, dans Totem normand pour un soleil noir, son dernier recueil, c'est prendre en compte deux éléments essentiels qui éclairent ses écrits : la « Normandité » et l'émotivisme.
Le
premier terme a été forgé par Léopold Sédar Senghor
dont on connaît les liens avec la Normandie. Lors d'une conférence privée à
l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen – le texte
intégral a été publié par les Éditions Lurlure en
2018 –, il avait pris grand soin de préciser que le terme de « Normandité » tel qu'il le concevait n'était pas la
« normanditude » et qu'il ne pouvait
être assimilé à celui de « négritude », dont le sens est tout
différent. Il y définissait la « Normandité »
comme « un lyrisme lucide » et disait de l'artiste normand,
qu'il soit écrivain, peintre ou musicien, qu'il était un « créateur
intégral, avec l'accent mis sur la création elle-même », un créateur
de beauté. Christophe Dauphin, qui connut Léopold Sédar
Senghor, a fait sienne cette « Normandité »,
à la fois dans sa singularité et son universalisme, une certaine manière de
vivre et de penser aux dimensions du monde sans perdre ses racines.
L'autre
élément, tout aussi important, est l'émotivisme. Le mot lui-même avait déjà été
évoqué par ses amis, Guy Chambelland et Jean Breton,
mais Christophe Dauphin lui insuffle, avec ses complices de la revue Les
Hommes sans Épaules qu'il dirige, une énergie nouvelle et en précise le
sens en l'inscrivant au croisement de la « poésie pour vivre » et
du surréalisme, sans oublier le grand ancêtre que fut Pierre Reverdy. Dans un
entretien avec la revue Ballast, il proposera cette définition : « L'émotivisme
est la création par une œuvre esthétique – grâce à une certaine
association de mots, de couleurs ou de formes qui se fixent et assument une
réalité incomparable à toute autre – d'une émotion particulière, et non
truquée, que les choses de la nature ne sont pas en mesure de provoquer en
l'homme. Car la poésie est uniquement en l'homme et c'est ce dernier qui en
charge les choses, en s'en servant pour s'exprimer. » Qu'on n'attende
pas de lui une quelconque poésie de recherche, forgée laborieusement à grand
renfort de clichés universitaires, et il n'est pas un mécano qui « trafique
le moteur du langage ». S'il parle d'esthétique, c'est d'une
esthétique de la rupture qui met les nerfs et la pensée à vif, qui « sabote
les sens » pour mettre le réel en dérangement, ce qui n'est pas sans
faire penser au « long, immense et raisonné dérèglement de tous les
sens », d'Arthur Rimbaud. Avec Totem
normand pour un soleil noir, superbement orné par Alain Breton, Christophe
Dauphin nous rappelle par ce titre qu'il appartient à un clan, s'inscrit dans une
lignée d'écrivains, d'origine normande mais pas seulement, avec une
prédilection pour ces poètes marqués du sceau du « soleil noir » que
sont, entre autres, Jean-Pierre Duprey, Jacques Prevel, Jean Sénac, Marc Patin. Le livre part d'une
adolescence révoltée en banlieue ouest de Paris où il déambule, « la
vase aux lèvres et la rage en bandoulière », parmi d'autres « compagnons
du gravier » au pied des tours. Dès les
premiers mots, le lecteur est bousculé, entraîné dans une « zone
d'extrême turbulence » entre l'être et le dire. Il sait qu'il ne
sortira pas indemne de cette lecture où la poésie travaille au-corps-à corps, à
« la hache d'un cri ». On n'en demandait pas moins de cet
écrivain qui « entre par effraction dans l'alphabet », et dans
le réel, car c'est « dans l'émotion seule du vécu que se forgent les
mots ». Il y a un double mouvement chez ce poète, vers l'extériorité,
y compris la réalité la plus sordide qu'il « fracture avec un pied de
biche », définitivement du côté des opprimés et des révoltés, en
France et ailleurs, ses « frères humains », et vers l'intériorité où
il faut creuser pour réveiller les rêves enfouis : « malaxe tes
régions reculées qui frottent leurs bois de fables contre l'épaule du
cri », écrit-il.
Deux vers
expriment clairement ce cheminement : d'une part, « les mots
boxent la langue avec les poings de la vie », d'autre part « la
poésie boxe les mots avec les poings du rêve ». Christophe Dauphin
nous entraîne vers une « connaissance par les gouffres », comme
l'écrivait si magnifiquement Henri Michaux. La violence de l'écriture n'en
masque pas la sauvage et ténébreuse beauté, mais au contraire la révèle : « Bouquet
d'orties en travers du cri qui recrache la mer dégaine ta vie
qui tourne sur toi-même dégaine et tire
à bout portant ton enfance tes
mots-poumons tes tripes qui lèvent l'ancre ton langage
qui plonge comme une sonde mal aiguisée
entre les vagues dans les
mille et un cauchemars de tes os. » Alain Roussel |
 Christophe Dauphin et Alain Breton, Totem normand
pour un soleil noir, éditions Les Hommes sans Épaules,
2020.
Christophe Dauphin et Alain Breton, Totem normand
pour un soleil noir, éditions Les Hommes sans Épaules,
2020.