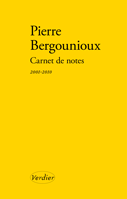|
Pierre Campion : L'écriture du survivant (sur les Carnets de Pierre Bergounioux).
Ce texte est paru dans le n° 1057 de la revue Europe en mai 2017, numéro consacré à Pierre Bergounioux et Jean-Paul Michel. Mis en ligne le 20 avril 2018. Voir sur ce site : L'écrivain à la table de peine, sur trois volumes des Carnets de notes de Pierre Bergounioux (2006, 2007, 2012).
L'écriture du survivantJ'ai pris, depuis longtemps, mes quartiers d'outre-tombe, habite déjà, en pensée, le sombre pays du néant. De sorte que les vivants, lorsque je les croise, me parlent, non pas de l'heure qu'il est mais du passé, quand j'étais l'un d'entre eux. Pierre Bergounioux, Carnets de notes, vol. 4, Je 9.4.2015, p. 1027. Presque tous les jours, chaque entrée dûment datée, depuis le mardi 16 décembre 1980 et (à ce jour) jusqu'au jeudi 31 décembre 2015, au long de quatre forts volumes papier bible, qui font un total de 4 678 pages, Pierre Bergounioux note l'heure de son lever (de bon matin, dans « l'impatience de comprendre », vol. 4, 154) et le temps qu'il fait, les signes sensibles de la saison, ses humeurs et sa santé, les occupations et les incidents domestiques, les journées d'enseignement et les obligations afférentes, les visites qu'il reçoit et les déplacements où on le convie, les alternances entre la maison de Gif (l'écriture, « à la table de peine ») et celle des Bordes en Corrèze (les vacances, la pêche, le travail du bois et des métaux de récupération), ses lectures et ses écritures, les unes et les autres souvent évoquées sans commentaires[1]. Littéralement, et d'ailleurs ainsi sous-titré, c'est un journal. Ces Carnets de notes ont leurs lecteurs, qui les attendent, en parlent entre eux et qui, étrangement, se passionnent pour cette masse de prose répétitive — ceux qui l'ont entendu, dans les nombreuses causeries qu'il donne ici et là, ajoutent : « Bergounioux parle comme il écrit, et il écrit comme il parle. » S'exprimant au nom de toute une génération qui eut à se sauver à tout prix d'un enclavement dans des terres et une histoire étouffantes, il dit volontiers : « C'était ça, ou mourir. » De même, dans le journal, il évoque « les deux ou trois alternatives qui se sont présentées à [lui] et dont l'un des termes était la mort. […] Il fallait mourir à soi, à tout et tenter de renaître » (4, 875 et 878). Car, depuis l'adolescence, le dos aux murs, il eut à affronter « les légions de l'adversité » (2, 1152), l'incompréhension des adultes et même leur brutalité, l'ignorance générale, le manque de sens : « Ce n'est pas travailler mais livrer bataille, comme disait Descartes, vider un différend d'une âpreté extrême avec la puissance ennemie qui garde et nous refuse les simples voies de notre sens » (2, 121). L'ennemi personnel de l'écrivain, en tant que celui-ci engage le sens de son existence — savoir ce qu'il en est, du monde et de soi —, revêt toutes sortes de formes et sollicite toutes sortes de métaphores. En dernière analyse, c'est la mort : celle des amis, celle de Norbert, le plus que frère (1, 720) — deux ans de coma — ; celle de Mitch, le presque jumeau, en 2014 ; celle du père en 1990 (1, 917), et dernièrement celle de Mam, la mère, en exil (4, 1172), à cent vingt lieues de Brive et de « la succursale de l'éternité que nous y tenions depuis plus d'un siècle » (4, 533). Et puis, c'est sa propre mort qui, depuis les deux derniers volumes mais revenue de plus loin, le menace maintenant de l'intérieur de son corps. L'ennemi est ancien, pérenne et intime : c'est l'ensemble des forces hostiles, mais intériorisées et par là rendues indéfiniment mortifères, c'est aussi « le tempérament funeste, l'opiniâtreté rigide, la certitude du pire et la propension au désespoir que j'ai touchés, au guichet des limbes » (1, 694). Ces forces, qui déferlent souvent en vagues de tristesse et réalimentées qu'elles sont par toute inquiétude et toute souffrance du présent, ce sont celles d'une adolescence malheureuse et d'un état de minorité toujours à l'œuvre dans l'adulte, celles de l'ignorance et de l'inculture à combattre notamment dans une débauche de lectures hétéroclites et un déploiement de curiosité de tout, celles même, enkystées, d'une condition ancienne de l'humanité et d'un type archaïque de société, inscrits dans un paysage dur et isolé, depuis les formations géologiques. L'écriture de ces volumes, c'est celle d'un homme qui fut sauvé par les lectures, par l'exil à Paris, par l'espoir placé dans le communisme, et surtout par la rencontre, à quatorze ans, de Cathy, « la princesse mandchoue ». Sauvé dans ces années de jeunesse d'une « crise aigu‘, presque mortelle » (1, 515), mais non une fois pour toutes et pour toujours. Car l'idée politique a fait long feu, l'exigence de sens demeure, obsessionnelle et inépuisable, et le contrat d'allégeance noué un jour avec « la plus accomplie des dames » (4, 567) demande à être renouvelé quotidiennement, des deux côtés : par l'humble demande de l'un et par la bienveillance gracieuse de l'autre. C'est le règne de l'inquiétude (« j'ai l'inquiétude pour demeure » 4, 377) : « Je ne sais plus ce que c'est que le temps libre ni la paix. Toujours une grande voix sévère me rappelle combien je suis ignorant et que je vais mourir, qu'il ferait beau voir que je sois un instant sans chercher à comprendre ce qui s'est passé avant que tout finisse. Le tribunal siège en permanence » (1, 372). Dans l'existence du survivant, ce qui l'emporte, sauf en de rares occasions (Cathy en apparitions, 3, 846 et 1016), ce n'est pas le bonheur d'être encore en vie, c'est la hantise de la mort. Ici, la curiosité dévorante (économie, sociologie, géographie, géologie, philosophie, entomologie, histoire, linguistique…) n'est ni un trait de caractère, ni le principe anthropologique de quelque libido sciendi ; c'est la recherche obligée d'un salut, par la connaissance de tout. Cette expérience n'est pas celle de « la vie intérieure » telle que la relatent souvent les diaristes : pas de lyrisme ni de spiritualité, pas ou très peu d'épiphanies du sens, mais des affects et des hantises, tels qu'ils se forcent un passage dans la conscience et la pensée. Pas d'intérieur profond et précieux, car toute sa vie est immédiatement présente au sujet, aux moments où il la constate et l'écrit : à telle heure, par telle disposition du jour et du climat, selon telle humeur de ma pensée et de mon corps, je suis toujours vivant — mais dépourvu de présent et de futur : « Le passé me hante. Les souvenirs me tirent à la renverse » (4, 337). Deux modes donc de cette survie, que l'on peut distinguer par commodité : l'épreuve de soi-même dans la présence fugitive aux choses mais aussi dans et par l'écriture, — distinction de principe seulement, car justement la présence quotidienne aux choses, aux êtres et aux événements ne s'éprouve que dans l'écriture du quotidien. Scribo, ergo sum. Non pas j'écris de profondes pensées, ni surtout un discours de pensée, mais ma vie dépouillée de tout autre mode que la simple existence, selon la forme modeste de mes méditations métaphysiques à moi, qui suis le sujet grammatical de cette vie-là. La vie donc au degré réduit, ramenée aux tâches domestiques, aux trajets sur l'autoroute, aux lectures compulsionnelles et aux écritures de commandes, et, pire, aux malaises cardiaques qui saisissent n'importe où, quand « la mort se dresse au seuil de l'instant suivant » (4, 164) et que « après, seulement, je constate, circonspect, tremblant, un peu incrédule, que je suis toujours vivant » (4, 300). Mais déjà, bien avant ces alertes récentes, l'écriture de la survie était en place, à l'ouverture du premier cahier. En marge de l'œuvre proprement dite et avant elle, et publiée pour la première fois en 2006 seulement, cette entreprise est confirmée dans sa spécificité à plusieurs reprises (« C'est le seizième [cahier] que je remplisse depuis sept ans que l'éventualité prochaine de mourir, le spectre de l'oubli m'ont poussé à garder trace des instants que nous aurons eus, de ce qui fut » lundi 28 décembre 1987, 1, 658), et encore dernièrement : « Ce n'est pas sans appréhension que j'entame ce nouveau cahier. Me demande sombrement, comme pour chacun de ceux que j'ai déjà remplis, depuis quelques années, s'il ne sera pas le dernier » (samedi 12 février 2011, 4, 28). Forcément, la tonalité évolue au fil du temps. Dans les troisième et quatrième volumes, au long des deuils et de la maladie, avec l'âge, et à travers les échecs de la gauche et l'avènement sous ses yeux d'« une humanité dégradée, décourageante » (4, 299), la tristesse et l'amertume assombrissent davantage l'écrivain. Avec les charges qu'apporte la notoriété et l'épuisement qui en résulte (travaux à la demande, entretiens et séminaires, séances de photos, radios et films, signatures de livres, « rencontres, déplacements, parlottes » 4, 253…), et surtout avec les graves incidents cardiaques des deux dernières périodes, le regard se porte maintenant sur le golem intime, sur ce nouvel inconnu de terre à épier, en soi-même, et à maîtriser si possible, et sur l'approche de « la parfaite absence dont on nous a tirés sans notre assentiment » (3, 923). C'est, toujours renouvelée, mouvante et occupée, mais de plus en plus précaire, la vie du survivant. Dans l'œuvre de Bergounioux et en arrière de celle-ci plutôt qu'en accompagnement[2], l'écriture du survivant a donc le jour de sa naissance, le mardi 16 décembre 1980 (1, 7) : « Ce cahier parce que je sens que s'effacent, à peine posées, les touches légères qui confèrent aux heures de notre vie leur saveur, leur couleur. Il ne subsiste plus, avec l'éloignement, que des blocs de quatre ou cinq années teintés grossièrement dans la masse. J'aimerais bien avoir conservé quelques lignes du temps d'avant — d'avant la conscience du monde et de soi, de la fièvre et de l'urgence, de la certitude de mourir. Mais c'est parce qu'elles m'étaient épargnées que je n'ai pas éprouvé le besoin de rien noter. » L'épreuve, c'est celle de la conscience malheureuse, et celle-ci a son histoire. Schématiquement, car les formules varient : il y eut d'abord l'immédiateté heureuse de l'enfance où l'on n'avait pas à se réfléchir, puis l'époque de la séparation d'avec le monde et de soi-même où l'on était trop pris à se sauver pour y penser, puis le temps enfin d'en écrire — surgi avant les récits en forme (Catherine, Miette, Le Matin des origines, La Mort de Brune…) —, cela pour évaluer « le prix qu'il a fallu payer, la négation active, acharnée, achevée de soi, sa reconstruction hasardeuse, à grands frais, sur d'autres fondements » (1, 515). La conscience du malheur vient après le malheur, avec l'effroi et la nécessité de le penser, d'y mettre des distinctions et de la clarté (Descartes, lu et relu). Seulement cet ordre ne peut pas être celui d'une histoire suivie ou d'un discours en forme : ce sera celui d'un ressassement quotidien, de la seule écriture propre à dire et redire le piétinement dans le pas d'une crise mortelle perpétuellement ravivée, c'est-à-dire propre à vivre le deuil impossible de soi-même. Hegel — lu et relu —, mais sans la perspective du dépassement. Cette vie-là est dévouée à « l'assidue fréquentation du désespoir » (1, 693). « Bergounioux parle comme il écrit, il écrit comme il parle. » Après que les folies théoriques sont passées, on peut le voir mieux : c'est cet homme-là que recherchent les lecteurs, « l'homme même » de Buffon, qu'ils reconnaissent de volume en volume, à la voix. Un homme disert, dont la parole fait corps avec son corps mais aussi avec celui de la langue. En effet, l'écriture du survivant, chaque jour, se réinvente dans la continuité de la langue française, celle-ci familière depuis les lectures dans la bibliothèque de Brive, enseignée ensuite pendant des années dans des collèges de la région parisienne puis aux Beaux-Arts, et pratiquée assidûment dans l'œuvre proprement dite. L'écriture du survivant exprime la labilité irrépressible de la parole, son exposition au corps et à sa disparition, dans la solidité de la grammaire française : de ses étymologies, ses accords, ses concordances des temps, ses ponctuations, son insolente reviviscence. Telle est cette prose très écrite, très grammaticale, et qui exige la vigilance du lecteur : on manquerait telle virgule, on perdrait le complément et le sujet, on lâcherait le fil des pronoms et des noms (« Mitch et Micheline », « Gaby et les siens »…), et le livre tomberait des mains. Mais rien de savant, rien de l'extrémisme mallarméen : simplement l'incorporation d'une histoire plus que millénaire dans un corps qui, sans cesse, se sent, se sait et se dit mortel. L'écriture du survivant est organique. Vivre, c'est écrire, au sens intransitif. Écrire, c'est survivre : « J'y suis, j'y suis toujours. » Un récit certes ou des récits, mais délibérément pauvres : en événements, en dramatisations, en analyses, en jugements (sinon en irritations). On lance la machine à laver et on pare aux sautes du disjoncteur, Cathy accueille des visiteurs par quelque gâteau, on fait des courses au supermarché, à la poste et à la pharmacie, on prend le RER à la station Courcelle (retards fréquents) puis le TGV pour se rendre à telle invitation : « Je change à Châtelet, sors Gare-de-Lyon avec dix minutes d'avance à peine. Il pleut à verse. Ma place se trouve dans la première des deux rames accolées » (4, 656)… Les lectures, innombrables, sont mentionnées presque toujours comme de simples faits, non pas sous la forme de la critique littéraire ou de l'analyse philosophique ; de même l'écriture des œuvres et opuscules : le format du papier, l'avancement des pages, l'envoi aux éditeurs, la correction des épreuves, la réception des exemplaires d'auteur, les « causettes » subséquentes… Redisons-le : rien qui devrait retenir des lecteurs, et pourtant ils sont là, relisant telles pages au hasard et remontant en arrière pour se rappeler les circonstances, se demandant entre eux des nouvelles de l'écrivain et de la famille (« les petits », même passé trente ans), se commentant les épisodes de cette vie épuisante, se retraçant les maisons, les déplacements, les noms des proches, des amis et des comparses… Serait-ce qu'eux-mêmes, lisant cette prose sévère, se prendraient à l'idée et à l'épreuve de leur propre condition de survivants ? Pierre Campion [1] Pierre Bergounioux, Carnet de notes 1980-1990 (2006), Carnet de notes 1991-2000 (2007), Carnet de notes 2001-2010 (2012) et Carnet de notes 2011-2015 (2016), tous chez Verdier. À la différence des précédents, le dernier en date des quatre volumes couvre cinq années et non pas dix : le quotidien déborde. [2] Une exception probablement : dans le volume 2, sur huit mois et une centaine de pages, on suit et commente l'écriture de Miette. |