|
Yves Fravalo : lecture d'un recueil de Jean-Pierre Boulic L'Eau de la grève est si bleue
Mis en ligne le 22 octobre 2020. Yves Fravalo enseigne la littérature à l'université permanente de Nantes. © : Yves Fravalo.
Une part de grâceL'art est, comme la prière, une main tendue dans l'obscurité, qui veut saisir une part de grâce pour se muer en une main qui donne. Franz Kafka Y a-t-il beaucoup de poètes qui sachent offrir à leur lecteur comme le fait si souvent Jean-Pierre Boulic, et singulièrement dans l'un de ses derniers recueils, L'Eau de la grève est si bleue[1], le sentiment de pénétrer dans ce que l'on aurait envie d'appeler l'intimité du monde ? Nulle violence, nulle effraction de la part du poète, aucune résistance du côté des choses. Celui qui parle, on le devine, on le sent en chacun des poèmes, est déjà là, et de toujours, « en ce lieu univers » où le lecteur est accueilli. Et c'est bien à l'évidence absolue et sans ombre d'un être-là immédiat que se trouve confronté de page en page ce lecteur, bienheureusement arraché au sentiment d'exil qui fait souvent pour lui le fond des heures. « Un art de
l'acupuncture »
La poésie moderne n'est pas narration. Plus que tout autre mode d'écriture, elle relève de ce que Julien Gracq désigne comme « un art de l'acupuncture ». Un art de la notation, de la notation brève ; brève et, comme telle, immédiatement soluble, non pas « dans l'air » – même si le lecteur ne peut qu'être sensible à l'usage heureux qui est fait ici ou là, comme chez Verlaine, de « l'impair » – mais dans l'imagination et la mémoire de chacun, quelle qu'ait été son histoire. Ainsi l'école du poème liminaire, que deux notations suffisent à poser dans sa réalité singulière, et pourtant universelle, (« La cour de récréation […] Le vieux lichen des moellons / Du préau ») renvoie-t-elle, comme celle du Grand Meaulnes – mais déportée des bords du Cher vers les portes de l'Océan – à toute école et à l'enfance du lecteur autant que du poète… ou du poème ; espace du jeu, du rêve, de l'apprentissage des mots, de leur pouvoir secret et de l'envol qu'ils favorisent dans le ciel un peu gris des premiers jours d'automne. Ouverture du lieu clos où le songe hésitant découvre et creuse au sein des choses familières l'épaisseur du mystère. Poème de la présence et du présent : on est loin ici de ce lyrisme un peu usé de la nostalgie, qui s'écrit au passé. Le monde est là, présent ; présent mais porteur de la profondeur du passé – un passé dont parlent le « lichen » gris, les fleurs fanées, la fuite des hirondelles – porteur aussi de la promesse du poème à venir : « Voyelles qui vous envolez |…] Je vous donne […] L'enfance du poème De ce mystère où s'auréole L'âme jusqu'aux confins des heures » (15) Je considérerais volontiers ce poème d'ouverture comme une sorte d'art poétique en action si je puis dire. Aucune théorie, aucun énoncé normatif, mais la mise en œuvre concertée d'une poétique éminemment consciente ainsi que le confirme ensuite l'ensemble du recueil. Savoir « demeurer »
Le poète n'est pas toujours « l'homme aux semelles de vent ». Il existe bien sûr une poésie de l'absence dont on connaît le fondement métaphysique, mais quels bienfaits nous dispensent les poètes dont l'art est de savoir « demeurer » : savoir se recueillir pour cueillir, accueillir. Recueillement, accueil et cueillaison : voilà les modalités du geste toujours repris que le lecteur a le sentiment de surprendre tout au long du recueil et auquel il est merveilleusement initié. « Je suis en ce lieu univers Demeurant là où le fil d'eau Parmi herbes et pierres glisse » (16) Alerté par une première occurrence du mot dès le second poème, l'esprit se fait immédiatement attentif au retour de ce verbe dont on sent bien qu'il doit livrer comme un secret, celui d'une façon d'être au monde. Ce qui est confié ici comme à voix basse, c'est le sentiment du privilège éprouvé au cœur même de la labilité des choses d'une permanence fondée sur la conscience de ce mouvement qui fait la vie. Habiter le monde, c'est se tenir à l'écoute du plus discret murmure, de la plus douce pulsation, c'est se tenir à l'écoute des signes les plus ténus d'un passage dont les mots du poème se donnent pour mission de suggérer le sens : « […] Demeurant là où le fil d'eau Parmi herbes et pierres glisse Avec escorte de mouettes Vers la mer et ses laminaires. » La poésie de Jean-Pierre Boulic est pleinement, on le voit, la poésie du signe et du sens ; mais comme on le voit aussi, loin de chercher à saisir ce sens à travers des concepts, loin de s'égarer dans l'abstraction, elle fait apparaître ce sens dans le seul déploiement du sensible, dans son seul dépliement. Et c'est en cela qu'elle est pleinement poésie. Dans le présent poème le regard se lève, la vision s'élargit, du sol au ciel et à la mer. L'infime ici parle de l'infini, de l'infini de l'espace ou du temps : « Ce présent où je demeure Un matin ensoleillé C'est l'instant miraculé D'un souffle d'éternité » (21) « Et je ferme les yeux Afin d'écouter le parfum Des chants Où demeure le cœur Du monde » (29) Bel effet de miroir entre ces deux poèmes où s'échangent les sujets (« je » / « cœur du monde ») d'un même verbe (« demeurer »), où se déplacent la position et la fonction du sujet humain, tour à tour accueilli, accueillant, enveloppé, enveloppant ; où s'inversent les dimensions : ouverture d'un infini dans l'étroitesse du moi pris dans l'étreinte de l'instant devenu seuil d'un éternel, et, par la clôture du regard et la nuit faite en soi, libération de forces neuves du sentir qui mènent sous une autre lumière vers le cœur même de la totalité. Et plus loin dans le recueil, avec d'autres implications : « Je demeure / En celui qui me nomme » (78) ; mot d'un poète qui a trouvé son lieu. Et encore : « L'aimer en tout cas / Pour ce qu'elle est / Et demeure / Avant que passe l'oubli… » ; il est question ici du miracle d'une voix surprise en son suspens précaire au sein des signes quotidiens (« geste » ou « regard ») ; suspens d'autant plus précieux sans doute qu'il est précaire, et voix dont une musique (« harpe », « luth ») toute mêlée de mots pourra, dans le poème, accueillir la lumière pour la lever vers « l'infini » creusé au cœur des « jours »… (88). Ainsi semble de page en page s'accomplir comme une dialectique dont on pourrait avoir le sentiment de trouver le secret dans un poème (25) où, à l'aide des termes les plus simples, s'égrène l'inventaire familier des choses les plus humbles (« Coquelicots et blés… / Parfums des champs… / Frênes et chênes / L'été dans le ruisseau / De cressons et de menthes / […] enfance / […] sourire d'une mère attentive… / Heures de la Saint-Jean / Odeurs lueurs de feux de nuit… / Prémices d'éternité ») : ce que suggèrent ces vers c'est que le sentiment de l'éternel est lié à celui d'un inépuisable pressenti dans ce qu'il y a de plus ténu (« coquelicot » ou « blé », « cresson » ou « menthe », « sourire, odeur, lueur… ») ; et cette promesse est donnée à sentir et comme à saisir par la grâce d'une écriture où le mot, le vers, le poème qu'ils composent parfois dans leur simple juxtaposition, pèsent d'un poids particulier qui impose un suspens tout nourri de silence. Le substantif et la musique du silence
Nous sommes ici, on le comprend, face à ce qu'on pourrait appeler une poésie du substantif, une poésie qui ne raconte pas, on l'a déjà noté, qui ne décrit pas, qui ne glose pas, qui, au sein du vers de peu de syllabes, au sein du poème bref, parvient à donner voix aux choses, aux « choses muettes », selon le mot de Baudelaire, simplement en les nommant : « Pétales sépales corolles et tigelles Pieds-d'alouette et dunes de genêts Roses agapanthes hortensias… » (17) en les inscrivant seulement dans l'ordre de la mesure et du vers ; et voilà que les choses, à travers les mots qui les disent, soudain sont devenues musique. Souvent le vers s'allège ; il se défait volontiers de l'article, ne retient que peu d'adjectifs et ce sont alors des adjectifs qui donnent pleinement à voir et à sentir : la paix du soir, la couleur des saisons, la fragilité, la proximité du silence : « Sycomores chênes châtaigniers (71) […] Hêtres tilleuls pommiers Prunus et peupliers Feuilles aux douces mains » (27) « Chardons figés Dunes roussies Sèches bruyères […] châteaux d'enfants Forteresses menues » (26) « Rochers aux mains nues Océan à voix basse Sable galets varechs… » (76) mouvement des mots vers une nudité qui est la nudité des choses saisies dans « Un frêle tremblement Tissé de vent » (79) Belle définition (« O clarté des mots ! ») de la profération poétique prise dans la pulsation qui fait la vie du monde : « Respirer, invisible poème », écrit Rilke. Mais ce dépouillement de l'écriture a pour envers à l'évidence une restitution des choses à leur richesse native ; le monde sensible n'a pas besoin des fioritures de l'écriture « artiste ». Le vrai poète sait s'effacer et ne faire de sa parole, humblement, que la parole du monde, la parole silencieuse et doucement musicale du monde : « Sur la dune un souffle passe Sans bruit sans pluie » (62) « La source bruisse Du talus glisse sa voix » (61) Il passe ici comme un souvenir de Verlaine ! Ecoutons encore « Les merles s'éveillent Pariade d'un instant Jeunesse du jour. Entendre le chant De ce moment […] Ecouter les signes » (57). Poésie de l'attention au monde, perçu, « reçu » comme une grâce, et auquel, en retour, le poète accorde la grâce du langage : « […] Je mets des mots Sur ce qui est reçu […] Je tends et je donne à ce monde […] Le souffle qui le fait vivre… » (83) Tout le recueil me paraît suivre le fil – inscrit en filigrane – d'une méditation sur cet échange ou cette osmose dont il est le lieu. « Un pays s'accomplit […] Dans l'échange de la parole » (33)… et, comme le « pays », le poème – et le poète peut-être aussi ? Venue du poème / genèse du monde
Tout cela semble merveilleusement condensé dans le si beau poème de la page 84, à lire bien évidemment comme un apologue sur la naissance du poème, une naissance où se rejoue comme le miracle d'une genèse. « Je les serrais au creux des mains Je croyais n'avoir que les mots Qui ont la clarté au matin Des étincelles de la source. C'est alors qu'un souffle s'en vint Séparant lumière et ténèbres. C'était bon. À même la terre Vivait la grive musicienne. » Deux strophes, deux temps dans l'acte mythique ici rapporté. Un état premier : la possession un peu jalouse d'un matériau (« les mots ») dont le sujet certes n'ignore pas le caractère précieux, un matériau dont la qualité ne peut se dire qu'en termes de lumière (« clarté », « étincelles »), en termes de promesse et de fécondité possible (« au matin », « source ») ; mais un matériau placé sous le signe de la pluralité (« les mots »), sous le signe de l'éclat et de l'éclatement (« étincelles ») ; d'une pluralité éclatée, exposée à la dispersion ; un bien précieux, mais menacé, d'où le sentiment du « ne… que… ». Puis un état second : le sujet n'est plus possesseur précautionneux, mais spectateur émerveillé ; s'effaçant de son propre énoncé, il laisse toute la place au dire de la merveille face à laquelle il se trouve, merveille placée sous le signe de l'humble au sens étymologique du terme (« À même la terre »), sous le signe de la vie, de la nature et du chant (« Vivait la grive musicienne »). Ce qui se vit d'un temps à l'autre, c'est l'éclosion du poème, évoquée en des termes qui font écho aux mots mêmes de la bible parlant du geste créateur : souffle et nomination ; geste qui sépare, qui distingue les éléments primordiaux (« lumière », « ténèbres »), qui ordonne le chaos pour en faire sourdre ce qu'en grec on appelle « cosmos », et qui est ordre et beauté. Et ce que le dernier vers (« Vivait la grive musicienne ») célèbre, ce qu'il donne à toucher, à sentir, à entendre dans sa qualité vocalique sans égale, c'est ce que Giono appelle si sobrement et si magnifiquement « Le Chant du monde » : le monde comme réalité musicale, la chose créée comme musique et source de musique, le vivant comme musicien. Ce qu'il semble dire, c'est l'état du monde et sa fonction, sa vocation (louange et célébration). Vocation que dit et célèbre le poème que nous lisons, vocation qui s'accomplit dans le poème ; poème qui, lui-même s'accomplit, en se confondant avec le monde naturel dont il porte le chant, un chant auquel il donne corps, en lui prêtant le corps du langage. Dans « la rumeur de l'océan »
Que de thèmes ou de motifs, on aurait plaisir à suivre tout au long du recueil : le thème de l'enfance, un des plus riche, avec celui de la voix et de la parole, avec celui du silence, auxquels il est lié, comme à celui du temps, de la profondeur des années, de la dilatation des heures (73), cette enfance qui seule sait reconduire vers les secrets du monde : « La voix de l'enfance poursuit son chemin Elle est dans le chant de l'oiseau » (44) Cette enfance qu'un poème saisit à l'instant du réveil étrangement mêlée dans un jeu de distance et de proximité à un monde qui hésite entre rêve et réalité : « La mer paraît lointaine Seul parvient le songe des vagues L'enfant tiré du blanc sommeil Par la corne de brume. » (75) Il y aurait à suivre aussi le motif du rocher, de la grève et du gris, dont la parenté phonique avec le mot grive donne à rêver ; et on trouverait là le décor du poème, sa couleur et le lieu du poète, selon l'aveu que l'on entend ici : « Je crois mon pas sans vanité Au paradis des brumes Habité d'oiseaux gris La mer s'incline ici Mes chants sont accrochés Aux rochers de la grève. » (64) Cette grève vers laquelle reconduit la « sente » plutôt que le sentier : le genre n'est pas indifférent dans ce recueil qui, si discrètement, chante l'absente – mère, grand-mère –, et tous les êtres simples qui sont passés sur les mêmes chemins dans « la rumeur de l'océan ». (50) Le parcours d'un poète
Il y aurait à évoquer ce qui passe de confidence et d'aveu, en pointillé, dans les poèmes des pages 40 à 43, si lourds de douloureuse « rémanence » et de remords : et c'est la scansion appesantie des « Je ne t'ai pas… » : « Je ne t'ai pas entendu partir Je n'ai pas vu s'éteindre la flamme […] Je n'ai pas mesuré la souffrance […] Je ne t'ai pas réconforté. » (41) Il y aurait à dire la charge d'émotion communiquée par l'inventaire, pourtant si fragmentaire et si éclaté, si allusif, de quelques-unes des étapes essentielles d'une vie où se résume le parcours d'un poète ; mal et douleur rédimés par l'aptitude à surprendre et à inscrire dans l'ordre de la parole « l'inédit / Chuchotement de la lumière ». Il fallait qu'il y ait cet arrière-plan d'épreuves traversées pour que pèse de tout son poids le prix de l'accès à la présence, qui apparaît bien ici comme la grâce reçue par le poète et dispensée par lui au lecteur qui a le privilège d'avancer à sa suite sur les « sentes » orientées vers l'eau bleue de la grève. Lecture inachevée, inachevable…
Tout ce qu'on dit d'un recueil de poèmes n'est sans doute jamais finalement qu'addition de fragments d'une lecture inachevée, inachevable… traversée trop rapide d'un paysage qui serait à revoir sous d'autres angles et sous d'autres lumières. Il y aurait aussi à s'engager sur d'autres voies en feuilletant d'autres recueils. Nombreux déjà les titres[2] d'une œuvre reconnue et deux fois couronnée de prix d'un réel prestige ! Diversité des livres et pourtant unité de l'œuvre, unité d'inspiration et de ton, unité d'orientation, fondée sur une même interrogation : « Mais qui ouvrira Le livre scellé Du lin de la nuit ? » (94) L'épure des dessins de Nathalie Fréour où l'on voit revenir l'arbre et l'oiseau suggère-t-elle une réponse ? Présence discrète de la main d'une artiste qui, loin de les remplir, semble creuser encore, et avec le plus grand bonheur, les plages de « silence » dont a besoin le poème pour « tisser » librement dans l'esprit du lecteur « les couleurs » qui sont les siennes. Yves Fravalo [1] Jean-Pierre Boulic, L'Eau de la grève est si bleue, Dessins
de Nathalie Fréour, Editions des Sources et des
Livres, 2018. [2]
On pourrait retenir parmi les plus récents :
Petites pièces pour instruments à voix,
Editions Petra, 2018 ; Laisser
entrer en présence, La Part commune, 2019 ; Tisser les couleurs du silence, Poèmes de Jean-Pierre Boulic, Aquarelles de Marie-Gilles Le Bars, L'enfance des
arbres, 2020. |
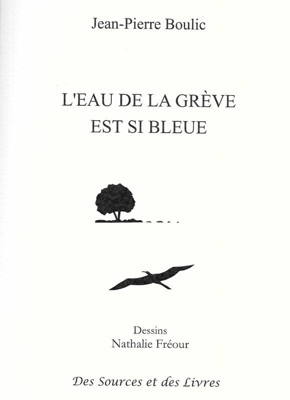 Jean-Pierre Boulic, L'Eau de
la grève est si bleue, Des Sources et des Livres, 2018.
Jean-Pierre Boulic, L'Eau de
la grève est si bleue, Des Sources et des Livres, 2018.