Hervé Martin : Note de lectuure sur la biographie d'Yves Congar par Étienne Fouilloux. Hervé
Martin a été Professeur d'histoire médiévale à l'université de Rennes 2. Mis en ligne le 2 juin 2021. © Hervé Martin.
Ce livre m'est parvenu tout à fait par hasard et je n'aurais pas eu l'idée de l'acheter en librairie. Il mérite cependant d'être connu, car il est écrit d'une plume alerte et sûre par Étienne Fouilloux, grand spécialiste du catholicisme au XXe siècle, et il comporte des informations très importantes sur l'évolution de l'Église en général et de l'Église de France en particulier, des années 1930 aux années 1990. Le destin du père dominicain Yves Congar a été, nous apprend Étienne Fouilloux, exceptionnel par bien des aspects. Il a souffert quatre fois de la captivité ou de l'exil au cours de son existence, pas moins. Seul saint Athanase d'Alexandrie a fait mieux au IVe siècle en subissant cinq exils ! Né à Sedan en 1904 dans une famille très catholique, d'origine dinannaise, Yves Congar a connu dans cette ville des Ardennes une très rude occupation allemande entre 1914 et 1918. Dans les années 20, il brûle d'un patriotisme christique, au nom duquel on doit consentir pour la défense de la patrie autant de sacrifices que le Christ pour le salut de l'humanité. Cette conception du patriotisme a plus à voir avec le national-catholicisme qu'avec le national-républicanisme cher à Pascal Ory. D'ailleurs Yves Congar a nourri, pendant sa période de formation chez les dominicains, d'évidentes sympathies pour l'Action Française, engendrées peut-être par l'exil de son ordre en Belgique de 1926 à 1939, du fait de la politique anticléricale des radicaux. Quand la France s'écroule au printemps 1940, Congar en attribue d'ailleurs la responsabilité à la République radicale, à l'école laïque et à l'esprit petit-bourgeois et individualiste de ses compatriotes. Il participe néanmoins du courant de rénovation du thomisme impulsé par le père Chenu, dont il est très proche. En lieu et place d'un système abstrait et intemporel, il s'agit de resituer la pensée novatrice de Thomas d'Aquin au cœur du chantier urbain et universitaire du XIIIe siècle. Prisonnier en Allemagne de 1940 à 1945, Yves Congar n'est pas, à son retour, persona grata auprès de la vieille garde thomiste qui a obtenu en 1942 la mise à l'écart du père Chenu. L'ambiance est tendue au Saulchoir et Congar ne porte pas dans son cœur le Saint-Office qu'il qualifie de Gestapo, rien de moins. Il n'est pas favorable à la proclamation, en 1950, du dogme de l'Assomption de la Vierge, que soutient la vieille garde dominicaine, en invoquant les aspirations de la piété populaire. Congar estime qu'à empiler les dogmes on se coupe encore plus des protestants et des autres chrétiens séparés. Il craint aussi l'avènement d'un « mariano-chistianisme », ce qui ne manque pas de sel quand on connaît la mariolâtrie des dominicains, qui ont inventé le culte du Rosaire à la fin du Moyen åge. À partir de 1947-48 éclosent, selon Étienne Fouilloux, « les cent fleurs du catholicisme français ». Le père Congar y prend toute sa part : il multiplie les interventions orales et sa production écrite est considérable. Tout en poursuivant ses travaux sur l'ecclésiologie, il devient une sorte de VRP de l'œcuménisme, au risque de susciter la méfiance des autorités vaticanes. Il collabore à Témoignage chrétien mais participe assez peu au courant du catholicisme social. Il se situe en quelque sorte au centre-gauche de la nébuleuse catholique et n'a pas d'atomes crochus avec les chrétiens progressistes, dont il se méfie. Il n'en est pas moins censuré par le Saint-Office en 1954 pour sa conception de l'Église et du rôle du laïcat en son sein, ce qui lui vaut un nouvel exil à Jérusalem, à Rome (!) et à Cambridge. Comme l'observe Étienne Fouilloux, « cela fait beaucoup pour un seul homme ». À Rome, il se sent désœuvré et ne manifeste aucun enthousiasme pour l'année sainte décrétée par Pie XII en l'honneur du centième anniversaire de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception de la Vierge. Il critique avec virulence le système mis en place par Pie XII, qu'il ramène à cette formule lapidaire : obéissance + mariolâtrie. Cette dernière prend, à ses yeux, des formes délirantes. Papolâtrie et mariodulie constituent les deux faces d'un système qui, à force d'empiler les dogmes et les condamnations des « hérétiques », s'est coupé de ses racines évangéliques. À la fin des années 50 et au début des années 60, s'annonce et se prépare le concile Vatican II, convoqué par le pape Jean XXIII. Une commission de théologiens est constituée, où les conservateurs sont majoritaires. Elle fait cependant une place à des consulteurs aux idées plus avancées, parmi lesquels on retrouve le jésuite Henri de Lubac et le dominicain Yves Congar. Ce dernier craint fort de servir d'alibi aux conservateurs et ne cesse de mettre en garde les chrétiens avides de changement contre une possible déception. Les carnets de Congar montrent à quel point il se méfie de la curie romaine et du Saint-Office, où sévit le redoutable cardinal Ottaviani. À l'époque, je lisais régulièrement La Croix, journal auquel mes parents étaient abonnés. Les papes, qu'il s'agît de Pie XII ou de Jean XXIII, y étaient l'objet d'un véritable culte et je ne me serais jamais douté, y compris en lisant le très progressiste Témoignage Chrétien, de la violence des affrontements que couvait en son sein l'Église catholique. L'un des mérites d'Étienne Fouilloux est de les mettre en pleine lumière. Quand s'ouvre le concile Vatican II, en octobre 1962, Yves Congar, qui sent le soufre et qui est d'un naturel réservé, ne semble pas destiné à en être une figure marquante. Le jésuite Jean Daniélou a plus d'entregent que le savant dominicain, avec lequel il s'entend d'ailleurs assez bien. À l'issue de la première session du Concile, en décembre 1962, le père Congar est un peu désabusé : il a le sentiment d'avoir été peu consulté et de n'avoir pas pesé sur les débats. Et c'est pourtant à ce moment que s'affiche, selon Étienne Fouilloux, « la gloire du père Congar ». Plusieurs de ses ouvrages sont édités ou réédités, on le considère comme l'un des meilleurs spécialistes mondiaux de l'ecclésiologie et de l'œcuménisme, on le sollicite pour des sessions ou des conférences, au risque d'altérer une santé fragile ! De 1963 à 1965, il s'adonne pleinement à l'œuvre conciliaire, au fil des sessions de cette illustre assemblée. Quand le concile s'achève, fin 1965, on peut mesurer l'influence que le père Congar y a exercée : huit des seize documents adoptés par Vatican II portent sa marque. Il a travaillé en étroite collaboration avec les théologiens belges, au point que l'on a pu parler d'un concile de Louvain tenu à Rome ! Cependant le savant dominicain n'est pas parvenu à infléchir les textes sur l'œcuménisme et sur la place du laïcat (en particulier des femmes) dans l'Église. Soulignons au passage que le regard de spécialiste porté par Étienne Fouilloux sur l'œuvre des pères conciliaires tranche avec la banalité des remarques de Jean-No‘l Jeannenney dans Le Rocher de SŸstens. Les observations de ce dernier sont dignes d'un Iroquois à la Curie ! Dans les années qui suivent le Concile, Congar s'en fait le défenseur, avec de Lubac et Daniélou, face à des intégristes toujours prêts à perturber une conférence et à des progressistes qui estiment, à juste titre, que les résolutions conciliaires enfoncent des portes ouvertes. Anecdote significative : quand Congar se rend en Pologne, il est bien accueilli par le cardinal Wojtyla à Cracovie, mais très mal reçu par le cardinal Wyszinski à Varsovie. Ce dernier lui reproche d'ignorer la dimension populaire et mariale du catholicisme polonais ! Malgré ses problèmes de santé et son peu de goût pour les voyages, « le théologien-type de Vatican II » doit répondre à de multiples invitations à des colloques, des sessions ou des conférences en Europe et dans les deux Amériques. Interprète et défenseur des résolutions du Concile, il se garde, à droite, des intégristes et, à gauche, des progressistes partisans de la théologie de la libération. Désireux de ne pas passer pour un « vieux réac » auprès des jeunes dominicains, il ne partage pas pour autant les conceptions révolutionnaires du père Cardonnel. Congar reste un homme de la tradition, dont les dernières années se passent à l'hôpital des Invalides, où il a été accueilli en tant qu'ancien prisonnier de guerre. Il doit attendre ses 90 ans pour recevoir le chapeau de cardinal, attribué bien avant aux jésuites Daniélou et de Lubac. On lui a fait payer certaines de ses audaces, en particulier ses réticences envers l'encyclique Humanae Vitae de Paul VI ! En dehors du cas, étudié à la loupe, du père Congar, ce livre a le mérite d'inciter à se rappeler combien la pensée catholique était brillante en France dans les années 1950-1970. Le Drame de l'humanisme athée d'Henri de Lubac fournissait un antidote à Nietzsche et à d'autres penseurs matérialistes ; La Pensée de Karl Marx de Jean-Yves Calvez, permettait de s'initier à la dialectique marxiste ; Emmanuel Mounier ouvrait une voie médiane entre capitalisme et socialisme ; La Revue de l'Action Populaire et Économie et Humanisme accordaient une grande place à la décolonisation de l'Afrique et aux espoirs qu'elle suscitait. Pour couronner le tout, Le Phénomène humain de Teilhard de Chardin ouvrait à l'humanité des perspectives grandioses. Plusieurs de ces auteurs avaient maille à partir avec le Saint-Office, mais peu importait pour les « cathos de gauche », qui disposaient d'une nourriture substantielle, dépourvue de toute bigoterie. À partir des années 70, la pensée catholique s'est étiolée et s'est avérée incapable de répondre aux questions soulevées par la révolte de mai 68. On doit cependant mettre à part les géniales fulgurances de Michel de Certeau aussi bien en histoire (voir Les Possédées de Loudun et son édition de la correspondance de Surin), qu'en épistémologie de l'histoire (voir L'Écriture de l'histoire) et en psychanalyse. Mais la réponse globale aux défis du temps n'est pas venue, peut-être pour la raison toute simple que le catholicisme, en tant qu'idéologie « totalitaire » aspirant à régir l'humanité entière, y compris dans ses comportements les plus intimes, avait bel et bien fait son temps. Désormais, les intellectuels catholiques, ou d'ascendance catholique, se sont cantonnés dans des domaines particuliers. L'historien Jean Delumeau a montré que la peur avait occupé une place essentielle dans la pastorale chrétienne du XIVe au XXe siècle et s'est posé une question majeure : Le Christianisme va-t-il mourir ? Le politologue René Rémond nous a appris que la droite française présentait trois visages : légitimiste, orléaniste et bonapartiste, le premier de ces courants étant inséparable de l'Église catholique. Les sociologues ont bien perçu que les Français se détachaient peu à peu du catholicisme : les études générales de Gabriel Le Bras et du chanoine Boulard ont été confirmées à la base par Yves Lambert dans Dieu change en Bretagne, monographie exemplaire consacrée à la commune de Limerzel dans le Morbihan. Tous ces travaux des années 70-90, y compris différentes histoires de diocèses (Vannes, Rennes, etc.), relèvent peu ou prou de l'inventaire après décès. Comme à la fin du XVIIIe siècle, la cathédrale est en ruine et nul ne sait qui s'attachera à la relever ! J'ai beau scruter l'horizon, je n'y vois point se lever un La Mennais, un Lacordaire, un Ozanam, un Péguy, un Claudel, un Maritain, un Bernanos ou un Mauriac. Je vois seulement Frédéric Lenoir s'avancer sur les voies d'un sacré indéfini. Hervé Martin |
|
|
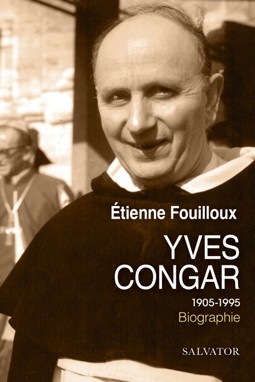 Étienne Fouilloux, Yves Congar 1904-1995. Biographie,
Salvator, 2020.
Étienne Fouilloux, Yves Congar 1904-1995. Biographie,
Salvator, 2020.