|
Roger-Yves Roche : Dans la chambre noire de la
mémoire.
© : Roger-Yves Roche. Roger-Yves Roche est maître de conférences en photographie et littérature à l’université Lumière Lyon 2.
Dans la chambre noire de la mémoire« Poursuites et ricochets » : mais d'où vient donc ce joli titre, qui tient à la fois de l'énigme et du mystère, façon jeu d'enfant, jeu de voyant ? De Denis Roche bien sûr, d'une de ces fulgurances dont il avait le secret, l'art de laisser fuser/infuser une formule, comme au cours de cette conversation avec Gilles Mora : « Ne rêvons pas… Laissons aux photos d'être des ricochets, et aux phrases d'être des poursuites. » Voilà en tout cas qui donne le la d'une collection consacrée aux photographies de famille et continue, poursuit !, une entreprise commencée dans les années soixante-dix par l'auteur de La Disparition des Lucioles, Dépôts de savoir & de technique et autres Preuves du temps. Et c'est justement sur l'évocation de Denis Roche que s'ouvre Tout autour de la photographie, premier ou second livre de la collection susnommée, signé Guillaume Geneste. Tout autour, chez Denis Roche, c'est ce qui précède, ou préside à. Autrement dit, la « montée des circonstances ». Ici, et pour ne pas aller contre l'idée, c'est ce que l'auteur, par ailleurs tireur de photographies (dont celles de Denis Roche, décidément…), raconte à partir de photos de sa famille qu'il a récoltées, je me demande s'il ne faudrait pas dire récolées, histoire d'affronter les histoires qui se terrent, et bien souvent se taisent, en toutes ces images. Tout autour de ces photographies, il y a donc l'absence, l'absence de celles et ceux qui ne sont plus là pour nous dire qui figure sur la photographie. Tout autour de ces photographies, il y encore le silence, ce vide abyssal devant lequel nous nous trouvons face au regard de celles et ceux qui ne nous laissent pour mémoire que leurs visages. Tout autour de ces photographies, il y a aussi l'angoisse, celle de voir et de ne pas savoir. Fascinantes sont à cet égard les photographies qui semblent muettes comme des tombes, telle cette maison à Biozat dans l'Allier qui « abrite » pourtant un drame effroyable qui eut lieu vers la fin du XIXe siècle : quatre enfants de la famille y moururent intoxiqués par des champignons ramassés et cuisinés par leurs grands-parents. C'est comme si Guillaume Geneste ouvrait grand les portes et fenêtres de la maison pour y faire entrer, enfin, les fantômes qui attendaient depuis la nuit des temps sur le seuil de l'image. Parfois la photographie se fait plus forte que la prose, gardant jalousement son, ses secrets : « Il y a une quinzaine d'années, notre mère, Hélène, soucieuse de ne pas perdre la mémoire photographique des ancêtres qui habitèrent les lieux où elle vit depuis sa plus tendre enfance, dans le Berry, rendit visite à plusieurs habitants de son village susceptibles de posséder encore d'anciennes photographies de famille. C'est chez l'un d'eux, Marcel Canon, alors âgé d'environ 85 ans, qu'elle découvrit cette photographie de mariage dont on ignore à peu près tout et surtout l'essentiel : qui sont les mariés ? » Parfois c'est la prose qui s'emballe, comme dans cet hallucinant curriculum, il faudrait dire continuum vitae, sans ponctuation aucune, qui semble vouloir lutter contre la disparition à l'œuvre : « et au centre Paul Auguste Ernest Barre notre bisaïeul né le treize septembre mille huit cent soixante-trois à Mareuil-sur-Arnon dans le Cher accoudé au bras de son père Édouard Scévola Barre bourrelier de profession et sacristain assis à côté de sa femme Catherine Margueritat qu'il entoure du bras et épouse le douze novembre mille huit cent quarante-quatre à Mareuil-sur-Arnon toujours dans ce même village où Catherine naît le vingt-six janvier mille huit cent vingt-six dix années après son mari Édouard qui voit le jour le cinq janvier mille huit cent seize » Et caetera. Cela donne, à la fin, un joli petit livret (de famille), entre plein et délié, absence et présence, mais où l'appartenance, la filiation si l'on préfère, s'entend à chaque coin de page, chaque recoin d'image… * Des
photographies du père de Marie-Hélène Lafon, on les sent, à dire vrai on les
sait, déjà matière à des récits d'avant, et les voilà qui resurgissent donc, en
chair et en os dira-t-on, à la faveur d'une commande de l'éditeur, dans ce
second ou premier livre de la collection citée plus haut : « j'ai
toujours connu les photos du service militaire de mon père.
Elles flottent depuis longtemps dans ma mémoire. En
2021, après sa mort, je les ai rassemblées
dans une enveloppe en papier kraft. C'était à moi
qu'il incombait désormais de les conserver, et la
proposition de David Fourré d'écrire pour la
collection « poursuites et ricochets » est arrivée
à point nommé. » S'agit-il d'un père oublié ? non reconnaissable ? ou encore impossible à appréhender, presque à nommer ? Toutes hypothèses qui restent à l'état d'hypothèses, et que les légendes, car il s'agit bien de légendes, écrites de la main de sa fille, ne parviennent ni à éclairer ni à obscurcir tout à fait : père qui pose en jardinier, père allongé sur la plage, une femme à ses côtés, père déguisé en ménagère, cuisinière, père qui joue avec le chien César. Père qui semble heureux au Maroc en ce temps-là, mais pourquoi ici, dans cet espace-temps et pas après son retour en France ? Identité n'est pas intimité… Au vrai, c'est bien la place du père au sein de la famille de l'écrivaine qui est l'enjeu de ce petit album, une place qui ne va pas de soi, tant les vingt-sept mois de service militaire au Maroc semblent une parenthèse définitivement hors parentèle. Comme si le père qu'elle avait eu n'était pas le père qu'elle (re)voyait, comme s'il lui échappait une seconde fois, autant peut-être qu'il échappait à lui-même : « Le palmier, le maillot de bain, le parasol, la plage de mon père sont d'un exotisme radical, ils ouvrent dans sa vie une parenthèse, peut-être enchantée, probablement douce, joyeuse, capiteuse, charnelle et cicatricielle ; je tâte de l'adjectif, j'avance à tâtons sur les traces du personnage que devient mon père dans une autre vie que la sienne. » Ainsi se
referme le livre, plein de mots forts et de colère rageuse, avec l'annonce de
« lendemains qui ne chanteraient pas ». Le reste ? Il est
entre les mots et les photos. Les déceptions de l'une et les illusions de
l'autre. Les ombres visibles et les reflets risibles de la mémoire : « Restent
les photos, celles de Casablanca, celles du mariage, et d'autres. Elles étaient pour la plupart éparses
dans leur armoire, et je les ai toujours connues. Elles s'inscrivent dans mes
livres, depuis longtemps, et résurgent ici ou là,
des Derniers Indiens en 2008 aux Sources en 2023. Je n'épuiserai pas leur mystère; je
les rends au silence des familles et des années. »
* Et la
collection de se poursuivre, et ricocher, on l'espère, de plus belle… Roger-Yves Roche |
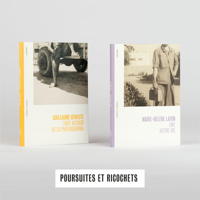 Guillaume Geneste, Tout autour de la photographie, 64 pages, et
Marie-Hélène Lafon, Une autre vie, 60 pages, coll. Poursuites et ricochets,
Éditions lamaindonne, 2023.
Guillaume Geneste, Tout autour de la photographie, 64 pages, et
Marie-Hélène Lafon, Une autre vie, 60 pages, coll. Poursuites et ricochets,
Éditions lamaindonne, 2023.