|
Pierre Campion : Compte rendu du récit de Michel Jullien, Intervalles de Loire.
© : Pierre Campion. Sur ce site, voir une recension par Daniel Morvan du livre de Michel Jullien, Les Combarelles. Sur ce site, voir une recension par Daniel Morvan du livre de Michel Jullien, L'Île aux troncs. Sur ce site, voir une recension par Pierre Campion du livre de Pierre-Henry Frangne, Michel Jullien et Philippe Poncet, Alpinisme et photographie 1860-1940.
Aux périls de la Loire, au risque de la littératureChaque écrivain a en vue toute la littérature, pour écrire en elle tout autre chose que tout ce qu'elle a déjà écrit. Michel Jullien a donc choisi de raconter la Loire — une descente de la Loire —, non pas pour les dangers que réservent ses courants ni ses bras morts ou ses ponts ni pour ses points de vue connus, mais parce que la Loire lui propose un défi d'écrivain. La Loire donc, par ce qu'il appelle ses intervalles et qui formeront l'autre vallée d'une vallée déjà très écrite : ni un guide, fût-il stendhalien ; ni un voyage, fût-il comme ceux de Nerval ou Flaubert ; ni une sociologie ni une histoire ; ni un récit d'exploit sportif, fût-il à la Blondin ; ni une méditation, ni une métaphysique, imitée d'Héraclite. Pas de profondeurs. On parcourra le grand fleuve français comme si de rien n'était, on traversera le grand lyrisme français sans le réciter ; on ne racontera ni les cadets de Saumur, ni le père Grandet, ni Léonard de Vinci, ni Vaché ou Breton, ni Madame de Sévigné, ni Gracq — celui-ci étant déjà passé par là, figure dangereuse d'un géographe qui s'était déjà décalé en écrivain. Ici on est toujours en pleine littérature, mais comme in abstracto. Et, quand un mot de Jules Renard ou de Julien Gracq ou de Mallarmé surviendra, ce sera au strict besoin des humeurs du récit : pas de pèlerinage à Chitry-les-Mines, pas de montée à Saint-Florent-le-Vieil, et le cimetière de Vulaines-sur-Seine ne relève pas de la Loire. Tous ces refus, tous ces dénis seront forcément et évidemment inscrits dans l'écriture. En somme, tout cela n'est pas ignoré, ni méprisé, ni moqué, mais aboli dans un autre fleuve, à inventer. Trois hommes à Nevers sur un pont, après boire. Ils vont avoir 50 ans dans un an. Parmi toutes les fantaisies qui se font jour à pareil moment et qui constatent sur un mode trivial le panta rhei des Anciens, celle-ci : descendre la Loire, l'année prochaine. Et, contrairement à presque toutes ces lubies-là, celle-ci reviendra, s'imposera, se réalisera, s'écrira. Trois hommes dans un bateau, mais pas ceux de Jerome K. Jerome ! Écueil encore plus périlleux, car, si tout intervalle à la Loire sera nécessairement dans un ton, dans une humeur, ici il faudra éviter, contourner, éluder la distance so british. L'humour sera potache, c'est-à-dire jouera sur le détournement des discours institués. Car ces trois-là visiblement ont lié amitié au lycée, trente ans auparavant : même classe d'âge, ils fêteront toujours la même année le même anniversaire. Telle est la génération née vers 1960. Dix ans avant 1968 et les fusées qui éclairèrent ceux qui étaient venus au monde, les veinards, avant 1950 ; vingt ans quand on leur promit à eux — divine surprise — de changer la vie ; trente ans quand la chute d'un mur à Berlin parut renouveler par un accident imprévu la promesse déjà bien écornée ; cinquante ans avant que celle-ci se soit définitivement dissipée. Les soixante-huitards ont reçu un nom commun et aussi les millennials mais, si cette génération apparemment n'intéresse personne, elle demeure quand même un petit mystère pour la précédente et peut-être pour elle-même. Par delà les destins diversement réussis, ce qui résiste, c'est les amitiés, les virées et les repas arrosés, les plaisanteries et le langage complices nés dans l'ennui des salles de classe et des cours de récréations… Dans une littérature qui se dit volontiers exténuée, avec envie Michel Jullien se saisit de son sujet. Raconter les préparatifs soigneux que les trois mettent à réaliser cette petite provocation — acheter la barque par le Bon Coin, l'amariner, la tester à vide, la charger et la lancer, à Andrézieux (Saône-et-Loire, lieudit choisi comme le point où le fleuve pourra la porter). Décrire de manière impersonnelle — pas de psychologie ! — les tours à la barre, à la vigie et aux rames, narrer du fleuve seulement ce qu'ils en voient, c'est-à-dire presque rien et au ras de l'eau. Et vogue à la mer ce bateau pas ivre, portant son équipage de bras cassés interchangeables et qui, malgré le pronostic de la génération suivante, ne s'engueula pas… Si la dignité de la littérature, c'est d'aller aux choses mêmes, au moment où et comme elles se donnent, alors ce livre-ci l'accomplit pleinement. Ce que ces garçons encore un peu gris, accompagnés d'épouses et enfants, ont vu du pont de Nevers et ce qui anime l'écrivain, c'est « l'inquiétante amitié de l'eau (non pas celle des océans, la mer ne mène nulle part) » : les trajets aléatoires d'un fétu perdu, les menus tourbillons en miniatures de Charybde et de Scylla, la portance du courant, la séduction discrète de ce qu'il cache : qu'y a-t-il sous cette surface irresponsable et sans repos, dans le lit de la Loire ? Une question qui n'aura de réponse que par épouser physiquement ce mouvement et par l'application d'un style : selon une prose familière et très travaillée — mais ce n'est pas du Céline non plus. Une manière de répondre à Baudelaire, mais tout en mineur, de saluer allusivement ses merveilleux nuages et son sonnet à la liberté : hommes libres, toujours, et malgré tout. À la surface de la prose Pas de récit linéaire, qui tournerait au drame ou à l'épopée. Pas de caractères. Un lyrisme, oui, mais constamment tenu en laisse. De brefs tableaux, séparés et composés après coup dans un savant désordre. Une vision éparpillée et synthétique, dérivante : le récit s'en va doucement vers l'embouchure du fleuve et des feux d'artifice conceptuels et stylistiques. Puis, « les trois nigauds de Nevers rendus à l'Atlantique », dernier coup de barre, il s'en retourne d'où l'aventure est sortie, une maison de la Nièvre, au bord d'un ruisseau insignifiant. Là, c'est Jules Renard, l'écrivain ironique et tendre des moments de l'enfance, le marginal de la littérature française qui aura le dernier mot. Des aspects du voyage, des aperçus fugaces, des petites proses titrées chacune : des statistiques ; des ponts ; des écarts du fleuve pour casse-croûtes et des îles pour dormir ; les bruits et les odeurs croisés entre les rives ; les ravitaillements au Super U du coin ; les épaves abandonnées aux négligences du courant ; des installations industrielles et portuaires… Plusieurs poèmes des trois bancs A, C, B, de la vigie, du barreur, du rameur. Chacun ses proses : mais la distribution du livre privilégie le rameur. Car c'est lui qui, au banc de nage et pendant son heure de quart, incarne la force motrice de l'équipage, affrontée directement en tout son corps aux forces ambivalentes du courant. La prose fait exactement ce qu'elle peut : briller de facettes, de surprises, d'images. Amuser la galerie, inventer brillamment du désordre, son ordre. Courses d'alimentation au Leclerc de Gien : la prose fait les pieds au mur (« Autre écart de fleuve », 78-81). Couleurs paradoxales du fleuve : Vers Saint-Mathurin, Ingrandes, la Loire devient grise. Non pas qu'elle le soit, elle donne une impression de gris même en août à midi. Pas argentée ni gris souris ou quoi que ce soit mais un gris cérébral comme on prête une couleur aux jours, aux nombres, aux voyelles. Une espèce d'oxymore mental : du mercure, un lit de mercure transparent, à densité limpide. (« Tricolore », 84) Des libellules, en grappes et en détails : L'une d'elles est venue se poser sur le bois de l'aviron, de ses six pattes. Un caprice. Même corps fuselé, l'aiguillon cambré, plastron indigo, une livrée électrique, un peu de bleu sur l'acajou. L'insecte se prélasse au centre du rondin, entre la poignée et la pale, les ailles ouvertes comme des Velux. (« Herbacée », 64) Les trois bancs, les trois fonctions dans l'existence sociale (exercées ici en alternance : penser, guider, travailler), par l'usage des mains : Le rameur a les mains occupées (tellement qu'il n'en aurait pas) ; un peu mieux pour le barreur, il dispose d'une main sur deux, l'autre est à la tâche, amputée. Le bel avantage du banc de proue tient à la pleine liberté que la vigie a de ses bras, seulement voilà, qu'en faire ? (« Addenda aux bancs A, B, C », 71-72) L'écrivain manie les ressources de son point de vue : le mouvement au ras des choses et des êtres, les effets de décentrement que celui-ci engendre, les leçons qu'il produit pour l'esprit. Ainsi dans cette description des pêcheurs à la ligne, brillante d'insolente ironie : Si aucun des pêcheurs n'a de visage, de motif plastique, d'ébauche identitaire, de raison propre, ce n'est pas leur accoutrement, la distance ou l'ombre portée sur les rives, c'est l'inaction dans laquelle ils baignent. L'attente les prive de visage, elle les absout. Ils ont remis leur psychologie à la durée, au vestiaire de la journée, ils étaient là hier, ils y seront demain, à l'asticot de sept heures du matin. Nous ne faisons pas mieux. Ils pêchent, nous passons en partage ; nous progressons, ils ne bougent pas, on se regarde à l'envers. […] Ainsi il n'y aura pas de visage, pas plus les leurs que les nôtres. Que voient-ils de nous, de nos faciès, de leur point de vue ? La barque à notre place se charge de nos figures. (« Autrui », 26 et 28) (Michel Jullien aurait-il en tête le pêcheur de la Vivonne dans Du côté de chez Swann, énigmatique lui aussi, mais unique, permanent, et enfermé dans un tout autre mythe, celui d'un narrateur transcendantal ? Vingt pages plus bas, on rencontrera les appels désespérés d'un arbre envasé, en réplique grandguignolesque, qui sait, aux clochers de Martinville.) En somme, le très écrit de ces proses participe du point de vue d'un livre qui se situe contre et dans la littérature. « Une morne récréation fluviale » ? (quatrième de couverture) L'ironie a ceci de salubre, de fascinant, et de pervers qu'elle se retourne, de fait et par construction, contre l'ironiste. Enregistré d'avance dans un gros recueil de cartes — le Navigator ! — et dans un stock de photos aériennes tirées de Google, d'après lesquels — et d'après ce qu'il voit, bigleux d'office —, l'homme de vigie crie des instructions au barreur aveugle, cependant que le rameur entre eux, regardant le paysage déjà écoulé, se brûle les mains aux avirons, le voyage se veut préparé à tout aléa, réglé comme du papier à musique. Mais, sur ces portées où même les silences et les repos sont notés, cette musique-là, sérieuse et sévère au possible à l'exécution, répétitive et éprouvante même, rappellerait trop bien les récréations anciennes et les fêtes laborieuses qui s'en suivirent. Savoir amer ? À 50 ans, toutes illusions perdues, il n'est pas trop tard pour saluer la beauté réelle des choses et de ses propres désirs, avec ironie, en s ‘asseyant sur ses genoux au banc de nage, mais sans toutefois l'injurier : une saison d'été dans un petit enfer revendiqué. Au plaisir de l'écrivain et de son lecteur, par son mouvement perpétuel d'invention, le travail de l'écriture du moins sauve tout. Pierre Campion |
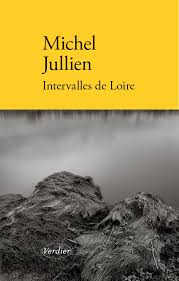 Michel Jullien, Intervalles de Loire,
Verdier, 2020.
Michel Jullien, Intervalles de Loire,
Verdier, 2020.